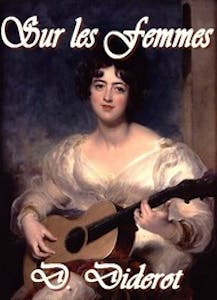Denis Diderot Sur les femmes Œuvres complètes de Diderot, Texte établi par J. Assézat, Garnier, 1875-77, II (pp. 251-262). (1772) -------------------------------------------------------------------------------- J'aime Thomas ; je respecte la fierté de son âme et la noblesse de son caractère : c'est un homme de beaucoup d'esprit ; c'est un homme de bien ; ce n'est donc pas un homme ordinaire. À en juger par sa Dissertation sur les Femmes [2], il n'a pas assez éprouvé une passion que je prise davantage pour les peines dont elle nous console que pour les plaisirs qu'elle nous donne. Il a beaucoup pensé, mais il n'a pas assez senti. Sa tête s'est tourmentée, mais son cœur est demeuré tranquille. J'aurais écrit avec moins d'impartialité et de sagesse ; mais je me serais occupé avec plus d'intérêt et de chaleur du seul être de la nature qui nous rende sentiment pour sentiment, et qui soit heureux du bonheur qu'il nous fait. Cinq ou six pages de verve répandues dans son ouvrage auraient rompu la continuité de ses observations délicates et en auraient fait un ouvrage charmant. Mais il a voulu que son livre ne fût d'aucun sexe ; et il n'y a malheureusement que trop bien réussi. C'est un hermaphrodite, qui n'a ni le nerf de l'homme ni la mollesse de la femme. Cependant peu de nos écrivains du jour auraient été capables d'un travail où l'on remarque de l'érudition, de la raison, de la finesse, du style, de l'harmonie ; mais pas assez de variété, de cette souplesse propre à se prêter à l'infinie diversité d'un être extrême dans sa force et dans sa faiblesse, que la vue d'une souris ou d'une araignée fait tomber en syncope, et qui sait quelquefois braver les plus grandes terreurs de la vie. C'est surtout dans la passion de l'amour, les accès de la jalousie, les transports de la tendresse maternelle, les instants de la superstition, la manière dont elles partagent les émotions épidémiques et populaires, que les femmes étonnent, belles comme les séraphins de Klopstok, terribles comme les diables de Milton. J'ai vu l'amour, la jalousie, la superstition, la colère, portés dans les femmes à un point que l'homme n'éprouva jamais. Le contraste des mouvements violents avec la douceur de leurs traits les rend hideuses ; elles en sont plus défigurées. Les distractions d'une vie occupée et contentieuse rompent nos passions. La femme couve les siennes : c'est un point fixe, sur lequel son oisiveté ou la frivolité de ses fonctions tient son regard sans cesse attaché. Ce point s'étend sans mesure ; et, pour devenir folle, il ne manquerait à la femme passionnée que l'entière solitude qu'elle recherche. La soumission à un maître qui lui déplaît est pour elle un supplice. J'ai vu une femme honnête frissonner d'horreur à l'approche de son époux ; je l'ai vue se plonger dans le bain, et ne se croire jamais assez lavée de la souillure du devoir. Cette sorte de répugnance nous est presque inconnue. Notre organe est plus indulgent. Plusieurs femmes mourront sans avoir éprouvé l'extrême de la volupté. Cette sensation, que je regarderai volontiers comme une épilepsie passagère, est rare pour elles, et ne manque jamais d'arriver quand nous l'appelons. Le souverain bonheur les fuit entre les bras de l'homme qu'elles adorent. Nous le trouvons à côté d'une femme complaisante qui nous déplaît. Moins maîtresses de leurs sens que nous, la récompense en est moins prompte et moins sûre pour elles. Cent fois leur attente est trompée. Organisées tout au contraire de nous, le mobile qui sollicite en elles la volupté est si délicat, et la source en est si éloignée, qu'il n'est pas extraordinaire qu'elle ne vienne point ou qu'elle s'égare. Si vous entendez une femme médire de l'amour, et un homme de lettres déprécier la considération publique ; dites de l'une que ses charmes passent, et de l'autre que son talent se perd. Jamais un homme ne s'est assis, à Delphes, sur le sacre trépied. Le rôle de Pythie ne convient qu'à une femme. Il n'y a qu'une tête de femme qui puisse s'exalter au point de pressentir sérieusement l'approche d'un dieu, de s'agiter, de s'écheveler, d'écumer, de s'écrier : Je le sens, je sens, le voilà, le dieu, et d'en trouver le vrai discours. Un solitaire [3], brûlant dans ses idées ainsi que dans ses expressions, disait aux hérésiarques de son temps : Adressez-vous aux femmes ; elles reçoivent promptement, parce qu'elles sont ignorantes ; elles répandent avec facilité, parce qu'elles sont légères ; elles retiennent longtemps, parce qu'elles sont têtues. Impénétrables dans la dissimulation, cruelles dans la vengeance, constantes dans leurs projets, sans scrupules sur les moyens de réussir, animées d'une haine profonde et secrète contre le despotisme de l'homme, il semble qu'il y ait entre elles un complot facile de domination, une sorte de ligue, telle que celle qui subsiste entre les prêtres de toutes les nations. Elles en connaissent les articles sans se les être communiqués. Naturellement curieuses, elles veulent savoir, soit pour user, soit pour abuser de tout. Dans les temps de révolution, la curiosité les prostitue aux chefs de parti. Celui qui les devine est leur implacable ennemi. Si vous les aimez, elles vous perdront, elles se perdront elles-mêmes ; si vous croisez leurs vues ambitieuses, elles ont au fond du cœur ce que le poëte a mis dans la bouche de Roxane : Malgré tout mon amour, si dans cette journée Il ne m'attache à lui par un juste hyménée ; S'il ose m'alléguer une odieuse loi ; Quand je fais tout pour lui, s'il ne fait tout pour moi ; Dès le même moment, sans songer si je l'aime, Sans consulter enfin si je me perds moi-même, J'abandonne l'ingrat, et le laisse rentrer Dans l'état malheureux d'où je l'ai su tirer. Racine, Bajazet, acte I, scène iii. Toutes méritent d'entendre ce qu'un autre poëte, moins élégant, adresse à l'une d'entre elles : C'est ainsi que, toujours en proie à leur délire, Vos pareilles ont su soutenir leur empire, Vous n'aimâtes jamais ; votre cœur insolent Tend bien moins à l'amour qu'à subjuguer l'amant. Qu'on vous fasse régner, tout vous paraîtra juste ; Mais vous mépriseriez l'amant le plus auguste, S'il ne sacrifiait au pouvoir de vos yeux Son honneur, son devoir, la justice et les dieux [4]. Elles simuleront l'ivresse de la passion, si elles ont un grand intérêt à vous tromper ; elles l'éprouveront, sans s'oublier. Le moment où elles seront tout à leur projet sera quelquefois celui même de leur abandon. Elles s'en imposent mieux que nous sur ce qui leur plaît. L'orgueil est plus leur vice que le nôtre. Une jeune femme Samoïède dansait nue, avec un poignard à la main. Elle paraissait s'en frapper ; mais elle esquivait aux coups qu'elle se portait avec une prestesse si singulière, qu'elle avait persuadé à ses compatriotes que c'était un dieu qui la rendait invulnérable ; et voilà sa personne sacrée. Quelques voyageurs européens assistèrent à cette danse religieuse ; et, quoique bien convaincus que cette femme n'était qu'une saltimbanque très-adroite, elle trompa leurs yeux par la célérité de ses mouvements. Le lendemain, ils la supplièrent de danser encore une fois. Non, leur dit-elle, je ne danserai point ; le dieu ne le veut pas ; et je me blesserais. On insista. Les habitants de la contrée joignirent leur vœu à celui des Européens. Elle dansa. Elle fut démasquée. Elle s'en aperçut ; et à l'instant la voila étendue à terre, le poignard dont elle était armée plongé dans ses intestins. Je l'avais bien prévu, disait-elle à ceux qui la secouraient, que le dieu ne le voulait pas, et que je me blesserais. Ce qui me surprend, ce n'est pas qu'elle ait préféré la mort à la honte, c'est qu'elle se soit laissé guérir. Et de nos jours, n'avons-nous pas vu une de ces femmes qui figuraient en bourrelet l'enfance de l'Église, les pieds et les mains cloués sur une croix [5], le côté percé d'une lance, garder le ton de son rôle au milieu des convulsions de la douleur, sous la sueur froide qui découlait de ses membres, les yeux obscurcis du voile de la mort, et s'adressant au directeur de ce troupeau de fanatiques, lui dire, non d'une voix souffrante : Mon père, je veux dormir, mais d'une voix enfantine : Papa, je veux faire dodo ? Pour un seul homme, il y a cent femmes capables de cette force et de cette présence d'esprit. C'est cette même femme, ou une de ses compagnes, qui disait au jeune Dudoyer, qu'elle regardait tendrement, tandis qu'avec une tenaille il arrachait les clous qui lui traversaient les deux pieds : Le dieu de qui nous tenons le don des prodiges ne nous a pas toujours accordé celui de la sainteté [6]. Mme de Staal est mise à la Bastille avec la duchesse du Maine, sa maîtresse [7] ; la première s'aperçoit que Mme du Maine a tout avoué. À l'instant elle pleure, elle se roule à terre, elle s'écrie : Ah ! ma pauvre maîtresse est devenue folle ! N'attendez rien de pareil d'un homme. La femme porte au dedans d'elle-même un organe susceptible de spasmes terribles, disposant d'elle, et suscitant dans son imagination des fantômes de toute espèce. C'est dans le délire hystérique qu'elle revient sur le passé, qu'elle s'élance dans l'avenir, que tous les temps lui sont présents. C'est de l'organe propre à son sexe que partent toutes ses idées extraordinaires. La femme, hystérique dans la jeunesse, se fait dévote dans l'âge avancé ; la femme à qui il reste quelque énergie dans l'âge avancé, était hystérique dans sa jeunesse. Sa tête parle encore le langage de ses sens lorsqu'ils sont muets. Rien de plus contigu que l'extase, la vision, la prophétie, la révélation, la poésie fougueuse et l'hystérisme. Lorsque la Prussienne Karsch [8] lève son œil vers le ciel enflammé d'éclairs, elle voit Dieu dans le nuage ; elle le voit qui secoue d'un pan de sa robe noire des foudres qui vont chercher la tête de l'impie ; elle voit la tête de l'impie. Cependant la recluse dans sa cellule se sent élever dans les airs ; son âme se répand dans le sein de la Divinité ; son essence se mêle à l'essence divine ; elle se pâme ; elle se meurt ; sa poitrine s'élève et s'abaisse avec rapidité ; ses compagnes, attroupées autour d'elle, coupent les lacets de son vêtement qui la serre. La nuit vient ; elle entend les chœurs célestes ; sa voix s'unit à leurs concerts. Ensuite elle redescend sur la terre ; elle parle de joies ineffables ; on l'écoute ; elle est convaincue ; elle persuade. La femme dominée par l'hystérisme éprouve je ne sais quoi d'infernal ou de céleste. Quelquefois, elle m'a fait frissonner. C'est dans la fureur de la bête féroce [9] qui fait partie d'elle-même, que je l'ai vue, que je l'ai entendue. Comme elle sentait ! comme elle s'exprimait ! Ce qu'elle disait n'était point d'une mortelle. La Guyon a, dans son livre des Torrents [10], des lignes d'une éloquence dont il n'y a point de modèles. C'est sainte Thérèse qui a dit des démons : Qu'ils sont malheureux ! ils n'aiment point. Le quiétisme est l'hypocrisie de l'homme pervers, et la vraie religion de la femme tendre. Il y eut cependant un homme d'une honnêteté de caractère et d'une simplicité de mœurs si rares, qu'une femme aimable put, sans conséquence, s'oublier à côté de lui et s'épancher en Dieu ; mais cet homme fut le seul ; et il s'appelait Fénelon. C'est une femme qui se promenait dans les rues d'Alexandrie, les pieds nus, la tête échevelée, une torche dans une main, une aiguière dans l'autre, et qui disait : Je veux brûler le ciel avec cette torche, et éteindre l'enfer avec cette eau, afin que l'homme n'aime son Dieu que pour lui-même [11]. Ce rôle ne va qu'à une femme. Mais cette imagination fougueuse, cet esprit qu'on croirait incoercible, un mot suffit pour l'abattre. Un médecin [12] dit aux femmes de Bordeaux, tourmentées de vapeurs effrayantes, qu'elles sont menacées du mal caduc ; et les voilà guéries. Un médecin [13] secoue un fer ardent aux yeux d'une troupe de jeunes filles épileptiques ; et les voilà guéries. Les magistrats de Milet [14] ont déclaré que la première femme qui se tuera sera exposée nue sur la place publique ; et voilà les Milésiennes réconciliées avec la vie. Les femmes sont sujettes à une férocité épidémique. L'exemple d'une seule en entraîne une multitude. Il n'y a que la première qui soit criminelle ; les autres sont malades. Ô femmes, vous êtes des enfants bien extraordinaires ! Avec un peu de douleur et de sensibilité (hé ! monsieur Thomas, que ne vous laissiez-vous aller à ces deux qualités, qui ne vous sont pas étrangères ?), quel attendrissement ne nous auriez-vous pas inspiré, en nous montrant les femmes assujetties comme nous aux infirmités de l'enfance, plus contraintes et plus négligées dans leur éducation, abandonnées aux mêmes caprices du sort, avec une âme plus mobile, des organes plus délicats, et rien de cette fermeté naturelle ou acquise qui nous y prépare ; réduites au silence dans l'âge adulte, sujettes à un malaise qui les dispose à devenir épouses et mères : alors tristes, inquiètes, mélancoliques, à côté de parents alarmés, non-seulement sur la santé et la vie de leur enfant, mais encore sur son caractère : car c'est à cet instant critique qu'une jeune fille devient ce qu'elle restera toute sa vie, pénétrante ou stupide, triste ou gaie, sérieuse ou légère, bonne ou méchante, l'espérance de sa mère trompée où réalisée. Pendant une longue suite d'années, chaque lune ramènera le même malaise. Le moment qui la délivrera du despotisme de ses parents est arrivé ; son imagination s'ouvre à un avenir plein de chimères ; son cœur nage dans une joie secrète. Réjouis-toi bien, malheureuse créature ; le temps aurait sans cesse affaibli la tyrannie que tu quittes ; le temps accroîtra sans cesse la tyrannie sous laquelle tu vas passer. On lui choisit un époux. Elle devient mère. L'état de grossesse est pénible presque pour toutes les femmes. C'est dans les douleurs, au péril de leur vie, aux dépens de leurs charmes, et souvent au détriment de leur santé, qu'elles donnent naissance à des enfants. Le premier domicile de l'enfant et les deux réservoirs de sa nourriture, les organes qui caractérisent le sexe, sont sujets à deux maladies incurables. Il n'y a peut-être pas de joie comparable à celle de la mère qui voit son premier-né ; mais ce moment sera payé bien cher. Le père se soulage du soin des garçons sur un mercenaire ; la mère demeure chargée de la garde de ses filles. L'âge avance ; la beauté passe ; arrivent les années de l'abandon, de l'humeur et de l'ennui. C'est par le malaise que Nature les a disposées à devenir mères ; c'est par une maladie longue et dangereuse qu'elle leur ôte le pouvoir de l'être. Qu'est-ce alors qu'une femme ? Négligée de son époux, délaissée de ses enfants, nulle dans la société, la dévotion est son unique et dernière ressource. Dans presque toutes les contrées, la cruauté des lois civiles s'est réunie contre les femmes à la cruauté de la nature. Elles ont été traitées comme des enfants imbéciles. Nulle sorte de vexations que, chez les peuples policés, l'homme ne puisse exercer impunément contre la femme. La seule représaille qui dépende d'elle est suivie du trouble domestique, et punie d'un mépris plus ou moins marqué, selon que la nation a plus ou moins de mœurs. Nulle sorte de vexations que le sauvage n'exerce contre sa femme. La femme, malheureuse dans les villes, est plus malheureuse encore au fond des forêts. Écoutez le discours d'une Indienne des rives de l'Orénoque ; et écoutez-le, si vous le pouvez, sans en être ému. Le missionnaire jésuite, Gumilla [15], lui reprochait d'avoir fait mourir une fille dont elle était accouchée, en lui coupant le nombril trop court : « Plût à Dieu, Père, lui dit-elle, plût à Dieu qu'au moment où ma mère me mit au monde, elle eût eu assez d'amour et de compassion, pour épargner à son enfant tout ce que j'ai enduré et tout ce que j'endurerai jusqu'à la fin de mes jours ! Si ma mère m'eût étouffée en naissant, je serais morte ; mais je n'aurais pas senti la mort, et j'aurais échappé à la plus malheureuse des conditions. Combien j'ai souffert ! et qui sait ce qui me reste à souffrir jusqu'à ce que je meure ? Représente-toi bien, Père, les peines qui sont réservées à une Indienne parmi ces Indiens. Ils nous accompagnent dans les champs avec leur arc et leurs flèches. Nous y allons, nous, chargées d'un enfant qui pend à nos mamelles, et d'un autre que nous portons dans une corbeille. Ils vont tuer un oiseau, ou prendre un poisson. Nous bêchons la terre, nous ; et après avoir supporté toute la fatigue de la culture, nous supportons toute celle de la moisson. Ils reviennent le soir sans aucun fardeau ; nous, nous leur apportons des racines pour leur nourriture, et du maïs pour leur boisson. De retour chez eux, ils vont s'entretenir avec leurs amis ; nous, nous allons chercher du bois et de l'eau pour préparer leur souper. Ont-ils mangé, ils s'endorment ; nous, nous passons presque toute la nuit à moudre le maïs et à leur faire la chica, et quelle est la récompense de nos veilles ? Ils boivent leur chica, ils s'enivrent ; et quand ils sont ivres, ils nous traînent par les cheveux, et nous foulent aux pieds. Ah ! Père, plût à Dieu que ma mère m'eût étouffée en naissant ! Tu sais toi-même si nos plaintes sont justes. Ce que je te dis, tu le vois tous les jours. Mais notre plus grand malheur, tu ne saurais le connaître. Il est triste pour la pauvre Indienne de servir son mari comme une esclave, aux champs accablée de sueurs, et au logis privée de repos ; mais il est affreux de le voir, au bout de vingt ans, prendre une autre femme plus jeune, qui n'a point de jugement. Il s'attache à elle. Elle nous frappe, elle frappe nos enfants, elle nous commande, elle nous traite comme ses servantes ; et au moindre murmure qui nous échapperait, une branche d'arbre levée… Ah ! Père, comment veux-tu que nous supportions cet état ? Qu'a de mieux à faire une Indienne, que de soustraire son enfant à une servitude mille fois pire que la mort ? Plût à Dieu, Père, je te le répète, que ma mère m'eût assez aimée pour m'enterrer lorsque je naquis ! Mon cœur n'aurait pas tant à souffrir, ni mes yeux à pleurer ! » Femmes, que je vous plains ! Il n'y avait qu'un dédommagement à vos maux ; et si j'avais été législateur, peut-être l'eussiez-vous obtenu. Affranchies de toute servitude, vous auriez été sacrées en quelque endroit que vous eussiez paru. Quand on écrit des femmes, il faut tremper sa plume dans l'arc-en-ciel et jeter sur sa ligne la poussière des ailes du papillon ; comme le petit chien du pèlerin, à chaque fois qu'on secoue la patte, il faut qu'il en tombe des perles ; et il n'en tombe point de celle de M. Thomas [16]. Il ne suffit pas de parler des femmes, et d'en parler bien, monsieur Thomas, faites encore que j'en voie. Suspendez-les sous mes yeux, comme autant de thermomètres des moindres vicissitudes des mœurs et des usages. Fixez, avec le plus de justesse et d'impartialité que vous pourrez, les prérogatives de l'homme et de la femme ; mais n'oubliez pas que, faute de réflexion et de principes, rien ne pénètre jusqu'à une certaine profondeur de conviction dans l'entendement des femmes ; que les idées de justice, de vertu, de vice, de bonté, de méchanceté, nagent à la superficie de leur âme ; qu'elles ont conservé l'amour-propre et l'intérêt personnel avec toute l'énergie de nature ; et que, plus civilisées que nous en dehors, elles sont restées de vraies sauvages en dedans, toutes machiavélistes, du plus au moins. Le symbole des femmes en général est celle de l'Apocalypse, sur le front de laquelle il est écrit : mystère. Où il y a un mur d'airain pour nous, il n'y a souvent qu'une toile d'araignée pour elles. On a demandé si les femmes étaient faites pour l'amitié. Il y a des femmes qui sont hommes, et des hommes qui sont femmes ; et j'avoue que je ne ferai jamais mon ami d'un homme-femme. Si nous avons plus de raison que les femmes, elles ont bien plus d'instinct que nous. La seule chose qu'on leur ait apprise, c'est à bien porter la feuille de figuier qu'elles ont reçue de leur première aïeule. Tout ce qu'on leur a dit et répété dix-huit à dix-neuf ans de suite se réduit à ceci : Ma fille, prenez garde à votre feuille de figuier ; votre feuille de figuier va bien, votre feuille de figuier va mal. Chez une nation galante, la chose la moins sentie est la valeur d'une déclaration. L'homme et la femme n'y voient qu'un échange de jouissances. Cependant, que signifie ce mot si légèrement prononcé si frivolement interprété : Je vous aime ? Il signifie réellement : « Si vous vouliez me sacrifier votre innocence et vos mœurs ; perdre le respect que vous vous portez à vous-même, et que vous obtenez des autres ; marcher les yeux baissés dans la société. du moins jusqu'à ce que, par l'habitude du libertinage, vous en ayez acquis l'effronterie ; renoncer à tout état honnête ; faire mourir vos parents de douleur, et m'accorder un moment de plaisir ; je vous en serais vraiment obligé [17]. » Mères, lisez ces lignes à vos jeunes filles : c'est, en abrégé, le commentaire de tous les discours flatteurs qu'on leur adressera ; et vous ne pouvez les en prévenir de trop bonne heure. On a mis tant d'importance à la galanterie, qu'il semble qu'il ne reste aucune vertu à celle qui a franchi ce pas. C'est comme la fausse dévote et le mauvais prêtre, en qui l'incrédulité est presque le sceau de la dépravation. Après avoir commis le grand crime, ils ne peuvent avoir horreur de rien. Tandis que nous lisons dans des livres, elles lisent dans le grand livre du monde. Aussi leur ignorance les dispose-t-elle à recevoir promptement la vérité, quand on la leur montre. Aucune autorité ne les a subjuguées ; au lieu que la vérité trouve à l'entrée de nos crânes un Platon, un Aristote, un Épicure, un Zénon, en sentinelles, et armés de piques pour la repousser. Elles sont rarement systématiques, toujours à la dictée du moment. Thomas ne dit pas un mot des avantages du commerce des femmes pour un homme de lettres ; et c'est un ingrat. L'âme des femmes n'étant pas plus honnête que la nôtre, mais la décence ne leur permettant pas de s'expliquer avec notre franchise, elles se sont fait un ramage délicat, à l'aide duquel on dit honnêtement tout ce qu'on veut quand on a été sifflé dans leur volière. Ou les femmes se taisent, ou souvent elles ont l'air de n'oser dire ce qu'elles disent. On s'aperçoit aisément que Jean-Jacques a perdu bien des moments aux genoux des femmes, et que Marmontel en a beaucoup employé entre leurs bras. On soupçonnerait volontiers Thomas et D'Alembert d'avoir été trop sages. Elles nous accoutument encore à mettre de l'agrément et de la clarté dans les matières les plus sèches et les plus épineuses. On leur adresse sans cesse la parole ; on veut en être écouté ; on craint de les fatiguer ou de les ennuyer ; et l'on prend une facilité particulière de s'exprimer, qui passe de la conversation dans le style. Quand elles ont du génie, je leur en crois l'empreinte plus originale qu'en nous. -------------------------------------------------------------------------------- 1.? Ce morceau se trouve dans la Correspondance littéraire de Grimm, année 1772, avec des changements qu'il s'est permis de faire ; nous ne rapporterons que deux variantes qui nous ont paru mériter quelque intérêt. (Br.) — L'article Sur les Femmes, quoique court, mérite bien d'être distingué des articles de pure critique au jour le jour comme Diderot en fournissait tant à Grimm. Il fait partie de cette série qu'il appelait les petits papiers, « c'est-à-dire les petits chefs-d'œuvre, » ajoute Sainte-Beuve. 2.? Essai sur le caractère, les mœurs et l'esprit des femmes dans les différents siècles. Paris, 1772, in-8°, fig. 3.? Saint Jérôme. (Br.) 4.? Crébillon, vers supprimés dans la scène première du deuxième acte de Catilina. (Br.) 5.? Voir dans la Correspondance de Grimm, année 1761, la lettre de La Condamine sur le crucifiement des dévotes jansénistes convulsionnaires. 6.? Du Doyer de Gastel, à la suite de La Condamine, rend compte, dans la même Correspondance de Grimm, du Miracle du jour de la Saint-Jean, 1759 ; c'est la sœur Françoise qui est l'héroïne de cette scène d'exaltation où les secours, comme on appelait ces tortures, sont des coups de hache, des coups d'épée, et finalement l'incendie du lit et de la robe de la patiente. Françoise était une fille de cinquante-huit ans, ce n'est pas elle qui fit au jeune Du Doyer l'étrange aveu rapporté par Diderot. 7.? À l'occasion de la conjuration du prince de Cellamare. (Br.) 8.? Il y a eu une improvisatrice prussienne de ce nom, mais plus connue sous celui de Karschin. 9.? « La coquette a envie d'avoir A pour ami, B pour amant, C pour mari. Le premier a pour lui la confiance, le second la passion, le troisième la vanité ; elle essaiera de A, se dégoûtera de B et gardera C. A règne sur le cœur, G sur la tête, et B sur ce mobile interne que les médecins appellent le plexus nerveux, que votre Diderot a nommé la bête féroce, et que nous autres savants, nous regardons comme remplaçant dans la mécanique de la femme la machine à vapeurs. » Récit exact de ce qui s'est passé à la séance de la Société des Observateurs de la Femme, le mardi 2 novembre 1802. Dans cette spirituelle parodie des faits et gestes de la Société des Observateurs de l'Homme, Lemontey, parlant de la décoration de la salle où se tenait la séance, dit qu'elle était décorée des « bustes de trois philosophes qui avaient particulièrement médité sur la femme : Thomas, Rousseau et Diderot. Le premier avait l'air de lire, le second de rêver, et le troisième de prêcher. La même variété se retrouvait dans les matières que le sculpteur avait employées : Thomas était en plâtre verni, Rousseau en bronze doré, et Diderot en lave brute. » Cette appréciation nous paraît aussi juste qu'ingénieuse. 10.? Mme Guyon, quiétiste célèbre du xviie siècle, qui séduisit, jusqu'à Fénelon, a été étudiée par M. Matter dans son livre le Mysticisme en France au temps de Fénelon Paris, Didier, 1866, in-18. Ses rêveries ont été publiées d'abord par fragments. Le traité des Torrents (spirituels), qui avait longtemps couru manuscrit, fut imprimé, pour la première fois, dans l'édition des Opuscules spirituels, Cologne, 1704, in-12. En 1790 on donna une édition complète des Œuvres de Mme Guyon, en quarante volumes in-8°, Paris, chez les libraires associés. 11.? Fait cité par Bayle dans les Pensées sur la comète de 1680. Il place la scène à Damas au temps de saint Louis. 12.? Le médecin Silva, consulté à Bordeaux par une foule de jolies femmes, qui se plaignaient de vapeurs et de maux de nerfs, leur répondit : « Ce ne sont pas des maux de nerfs, c'est le mal caduc. » Le lendemain, il n'y eut plus une seule femme dans Bordeaux qui eût mal aux nerfs. (Br.) 13.? Boerhaave guérit une épidémie d'hystérie en menaçant les malades du cautère. 14.? Variante : « Le dégoût de vivre saisit les femmes de Milet, les magistrats déclarent que, etc. » 15.? Histoire naturelle, civile et géographique de l'Orénoque. Un des premiers collaborateurs de Diderot, Eidous, avait traduit cet ouvrage en 1758. Avignon et Paris, 3 vol. in-12, fig. 16.? Variante : « Affranchies de toute servitude, je vous aurais mises au-dessus de la loi ; vous auriez été sacrées en quelque endroit que vous eussiez paru. Quand on veut écrire des femmes, il faut, monsieur Thomas, tremper sa plume dans l'arc-en-ciel, et secouer sur sa ligne la poussière des ailes du papillon. Il faut être plein de légèreté, de délicatesse et de grâces ; et ces qualités vous manquent. Comme le petit chien du pèlerin, à chaque fois qu'on secoue sa patte, il faut qu'il en tombe des perles, et il n'en tombe aucune de la vôtre. » — M. Villemain (Cours de littérature), critiquant cette phrase, était blessé, non pas d'y voir Thomas gratifié d'une patte, mais bien l'arc-en-ciel changé en encrier. L'image est peut-être en effet un peu risquée, mais elle est si expressive ! 17.? Cette leçon est à peu près celle que Diderot donnait un jour à sa fille, et qu'il rapporte dans sa lettre à Mlle Voland, du 22 novembre 1768. .