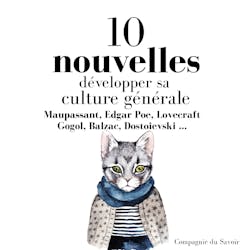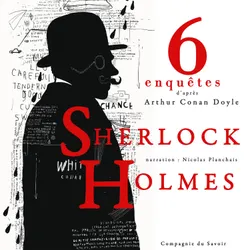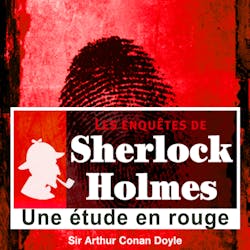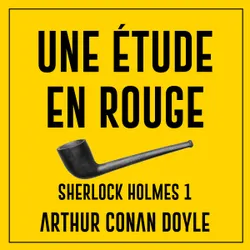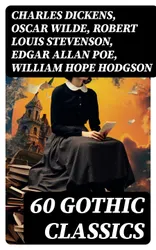Arthur Conan Doyle
LA BRÈCHE AU
MONSTRE
Traduction : Louis Labat
1925
LA BRÈCHE AU MONSTRE
Le récit qu’on va lire fut trouvé parmi les papiers du Dr James Hardcastle, mort de la phtisie, le 4 février 1908, au numéro 36 d’Upper Coventry Flats, South Kensington. Les familiers du docteur, tout en refusant de se prononcer sur les faits en cause, s’accordent à parler de lui comme d’un esprit pondéré, scientifique, totalement dépourvu d’imagination, et le moins fait du monde pour forger une histoire aussi anormale. L’enveloppe contenant le document portait cette suscription : « Récit sommaire de ce qui arriva, au printemps de l’année dernière, près de la ferme de Miss Allerton, dans le nord-ouest du Derbyshire. » Elle était cachetée. Sur le revers avaient été tracées au crayon les lignes suivantes :
« Mon cher Seaton,
« Vous apprendrez avec intérêt, peut-être avec peine, qu’en refusant d’ajouter foi à mon histoire vous m’aviez à jamais ôté l’envie de revenir là-dessus. Je laisse après moi les pages ci-jointes, espérant qu’il se trouvera des étrangers pour me faire plus de crédit que mon ami. »
Malgré les recherches, on n’a jamais pu savoir qui était ce Seaton. En revanche, divers témoignages ont parfaitement confirmé le séjour du défunt à la ferme d’Allerton et la nature des alarmes dont il parle. Ceci dit en guise de préambule, je reproduis son récit mot pour mot. Il se présente sous la forme d’un journal, dont certains passages ont été développés, alors qu’on en biffait certains autres.
17 avril. – Je ressens déjà la merveilleuse influence de l’air des hauteurs. La ferme des Allerton s’élève à quatorze cents pieds au-dessus du niveau de la mer, l’atmosphère y est donc forcément tonique. En dehors de mes quintes matinales, je n’éprouve plus que de très légères incommodités. Le lait pur et le mouton de la ferme ne peuvent manquer de me rendre du poids. J’espère que le professeur Saunderson sera content.
Les demoiselles Allerton sont deux personnes d’une bonté et d’une originalité charmantes, deux vieilles filles sans cesse à la besogne, toujours prêtes à reporter sur un étranger malade la sollicitude qu’elles auraient eue pour un mari ou pour un enfant. C’est vraiment une utile créature que la vieille fille, c’est l’une des réserves d’énergie que possède la collectivité humaine. On parle des femmes qui ne servent à rien sur la terre : que deviendrait, sans elles, le pauvre homme qui n’y sert à rien ? Ces demoiselles Allerton, dans leur simplicité, ne se sont pas longtemps demandé pourquoi Saunderson recommandait leur ferme ; le professeur est sorti du peuple, je crois qu’en son jeune âge il n’avait pas de fonction plus relevée que de pourchasser les corbeaux dans les champs d’ici.
Cette contrée solitaire offre au marcheur les promenades les plus pittoresques. La ferme a pour dépendances des herbages au fond d’une vallée irrégulière. De chaque côté s’élèvent de fantastiques escarpements calcaires, formés d’une roche si tendre qu’on la brise avec la main. Tout le pays est creux. On le frapperait avec un marteau géant qu’il résonnerait comme un tambour ; peut-être même en crèverait-on le dessus, mettant ainsi au jour une grande mer souterraine. Certainement il y a là un océan caché, car de partout des ruisseaux se déversent au milieu des rochers, et, quand on y pénètre, on se trouve dans de vastes cavernes qui s’enfoncent en serpentant jusqu’aux entrailles de la terre. J’ai une petite lampe de bicyclette ; c’est pour moi une perpétuelle joie que de la promener à travers ces retraites ignorées, d’admirer les effets que j’éveille, les contrastes d’argent et de noir que je suscite en projetant la lumière sur les stalactites qui drapent les hauts plafonds. J’éteins la lampe, c’est l’obscurité absolue ; je l’allume, c’est un décor des Mille et une Nuits.
L’une entre autres de ces ouvertures présente un intérêt spécial, car elle est l’œuvre non pas de la nature, mais des hommes. Jamais, avant ma venue dans ce pays, je n’avais entendu parler de « Blue John » : c’est un minéral d’une belle nuance pourpre, qu’on ne trouve qu’en un ou deux endroits du monde, et si rare qu’un vase de taille ordinaire, fait de Blue John, vaudrait un grand prix. Les Romains, avec la prodigieuse sûreté d’instinct qui leur était propre, s’étant avisés qu’on devait le découvrir dans cette vallée, creusèrent un puits profond dans la montagne. L’orifice de cette mine est ce qu’aujourd’hui l’on appelle la Brèche de Blue John. Nettement découpé en arcade dans le roc, il se cache à demi sous la broussaille. Les mineurs romains ont pratiqué là une galerie de belles dimensions, qui traverse quelques-unes des cavernes creusées par le travail des eaux, de sorte qu’en entrant dans la brèche de Blue John il n’est que prudent de jalonner sa route et d’être bien approvisionné en bougies, sans quoi l’on risque de ne jamais revoir le soleil. Je ne m’y suis pas encore engagé sérieusement ; mais aujourd’hui même, plongeant mon regard, de l’entrée, dans les lointains de ce tunnel, je me suis promis que, ma santé revenue, j’en explorerais à loisir les mystérieux détours, et que je saurais par moi-même jusqu’où les Romains avaient pénétré sous les collines du Derbyshire.
Drôles de superstitions que celles des paysans ! J’aurais eu meilleure opinion du jeune Armitage ; il ne manque ni d’éducation ni de caractère, c’est vraiment un garçon très fin pour sa condition. J’étais dans la Brèche de Blue John quand il traversa la prairie pour me rejoindre.
— Eh bien ! docteur, me dit-il, vous n’avez pas peur ?
— Peur ? lui répondis-je. Peur de quoi ?
— Mais, fit-il en désignant d’un geste du pouce l’arceau ténébreux, peur du monstre qui habite cette caverne !
La légende se crée vite au fond d’une campagne perdue. J’interrogeai Armitage sur les motifs de sa bizarre croyance. Il arrive que, de temps en temps, des moutons disparaissent, – enlevés, à ce qu’il prétend. J’objectai qu’ils peuvent fort bien s’égarer tout seuls dans la montagne, pour s’être trop écartés du troupeau : il refusa de l’admettre. Sans doute on a trouvé, un jour, une mare de sang et quelques touffes de laine ; mais cela aussi, représentai-je, peut s’expliquer d’une façon très naturelle. Les nuits où les moutons disparaissent sont invariablement des nuits très sombres, orageuses ou sans lune ; à quoi je répliquai qu’un voleur de moutons n’en choisirait pas d’autres pour opérer. Dans une de ces occasions, un grand trou avait été fait au mur, dont les débris couvraient le sol sur une longueur considérable : preuve encore, à mon avis, d’une intervention humaine. Enfin, Armitage couronna sa démonstration en me disant qu’il avait positivement entendu le monstre : en réalité, il avait entendu ce que tout le monde pourrait entendre, à la condition de demeurer assez longtemps près de la brèche, c’est-à-dire un grondement énorme et lointain. Et je souris de l’interprétation qu’en donnait Armitage, sachant les résonances particulières que déterminent des eaux souterraines quand elles roulent dans des abîmes de formation calcaire. Mon incrédulité finit par agacer Armitage ; il me tourna le dos et me planta là, non sans brusquerie.
Et voici le plus étonnant de l’affaire. J’étais encore à la même place, ruminant ce que m’avait dit Armitage avant de me quitter et songeant combien l’explication en était simple, quand l’arceau de la brèche répercuta tout à coup un bruit extraordinaire. Comment en donner l’idée ? D’abord, il semblait venir du tréfonds du sol ; ensuite, malgré la distance, il avait une force singulière ; enfin, ce n’était ni le bouillonnement d’une eau qui se précipite, ni le fracas de rochers qui s’éboulent ; c’était une grande plainte chevrotante et vibrante, presque pareille au hennissement du cheval. L’incident avait, certes, de quoi me surprendre ; j’avoue que pendant une minute il prêta, pour moi, une signification nouvelle aux propos d’Armitage. J’attendis près d’une heure et demie devant la brèche ; mais le bruit ne se renouvela pas, et je m’en revins à la ferme assez intrigué. Décidément, lorsque j’aurai repris quelque vigueur, j’explorerai cette caverne. L’explication d’Armitage est, bien entendu, absurde et ne supporte pas la discussion. Mais le bruit n’en était pas moins insolite. Je l’ai encore dans l’oreille au moment où j’écris.
20 avril. – Durant ces trois derniers jours, j’ai fait plusieurs expéditions à la Brèche de Blue John ; j’y ai même tant soit peu pénétré ; mais ma lanterne de bicyclette est si petite et si faible que je n’ose me risquer très loin. Je procéderai d’une façon plus systématique. Le bruit que j’avais entendu ne s’est toujours pas reproduit ; je crois que j’aurai été la victime d’une hallucination, due peut-être à ma conversation avec Armitage. Si ridicule que l’idée paraisse, je conviens qu’à voir les broussailles dont l’entrée de la caverne est obstruée, on dirait qu’un gros animal les a forcées pour s’ouvrir un passage. Voilà ma curiosité piquée au vif. Je n’ai rien dit aux demoiselles Allerton, car elles sont déjà suffisamment superstitieuses ; mais j’ai acheté des bougies et compte me renseigner tout seul.
Parmi les nombreuses touffes de laine que les moutons ont laissées aux ronces près de la caverne, j’en ai, ce matin, remarqué une, tachée de sang. Certes, la raison me dit qu’en errant dans un endroit rocailleux les moutons peuvent s’y blesser ; néanmoins, cette éclaboussure rouge m’a donné un choc imprévu, et je me suis surpris à reculer d’horreur devant le vieil arceau romain. Une haleine fétide semblait s’exhaler du couloir obscur que fouillaient mes yeux. Pouvais-je croire qu’il y eût là, aux aguets, je ne sais quel innommable danger, quelle effroyable créature ? Pareille idée ne me serait pas venue au temps où j’étais valide. Mais avec une santé débile, on devient l’esclave de ses nerfs, la proie de l’imagination.
Ma résolution faiblit un instant, et je fus tout près de renoncer à connaître le secret de l’ancienne mine, s’il existe. Ce soir, la curiosité m’est revenue, mes nerfs ont repris leur aplomb. J’espère aller plus avant, demain, dans mes recherches.
22 avril. – Je voudrais dire avec une exactitude scrupuleuse mon invraisemblable aventure de ce jour. J’étais parti dans l’après-midi pour la Brèche de Blue John. Je ne cache pas qu’en regardant à l’intérieur je sentis renaître toutes mes craintes et regrettai de n’avoir pas amené de la compagnie pour mon exploration. Cependant ma résolution l’emporta, j’allumai ma bougie, je me frayai un chemin à travers la bruyère et descendis dans le puits rocheux.
Il s’inclinait à angle aigu jusqu’à cinquante pieds, jonché, sur toute sa longueur, de débris de pierres ; puis il s’allongeait en un couloir étroit, taillé dans la roche dure. Sans être géologue, je reconnus que la paroi en était d’une matière plus résistante que la pierre à chaux, car je distinguais çà et là les marques d’outils laissées par les mineurs romains, aussi fraîches que si elles avaient daté de la veille. Je me dirigeais en trébuchant le long de l’antique corridor, car la petite flamme de ma bougie ne faisait autour de moi qu’un cercle de pâle lumière, au delà duquel l’ombre était plus menaçante et plus opaque. Enfin j’arrivai à un endroit où le tunnel débouche sur une caverne creusée par les eaux, vaste salle que les dépôts-calcaires ont comme tapissée de glaçons. De cette chambre centrale j’apercevais un grand nombre de galeries que les cours d’eau souterrains avaient forées en s’engouffrant au cœur de la terre. Je m’arrêtai, doutant si je ne ferais pas mieux de m’en retourner que de m’aventurer dans ce périlleux labyrinthe, quand je découvris à mes pieds une chose qui arrêta mon attention.
Les éboulis et les incrustations de chaux durcie recouvraient dans sa plus grande partie le sol de la caverne ; mais à la place où je me trouvais, il s’était fait, très haut dans la voûte, une gouttière, au-dessous de laquelle un espace de terrain détrempé, boueux, montrait, juste à son centre, une énorme empreinte, mal définie, profonde, large et irrégulière, comme celle qu’aurait pu faire un quartier de roc en tombant. Mais il n’y avait à proximité ni une pierre détachée ni rien qui expliquât cette marque. Ses dimensions ne permettaient pas de l’attribuer à un animal ; en outre, elle était seule, et l’espace de terrain détrempé était beaucoup trop large pour pouvoir être franchi d’une enjambée. Je confesse qu’au moment où je me relevai après l’avoir examinée, promenant mes yeux sur les ombres qui me cernaient de toutes parts, j’eus une défaillance de cœur, et malgré moi la bougie tremblait dans ma main.
Toutefois, je dominai vite mes nerfs en songeant combien il était déraisonnable de voir, dans une empreinte si colossale et si informe, le fait d’aucun animal connu. Un éléphant même ne l’eut pas produite. Je décidai donc que je ne me laisserais pas arrêter dans mon exploration par des craintes aussi gratuites que vagues. Avant de poursuivre, j’eus soin d’étudier la formation très spéciale de la muraille rocheuse, pour être certain de reconnaître l’entrée de la galerie romaine : précaution utile, car la grande caverne semblait traversée de nombreux couloirs. La position ainsi relevée, rassuré en constatant ce qui me restait d’allumettes et de bougies, je m’avançai sur le sol inégal et pierreux de la caverne.
C’est alors qu’arriva brusquement la tragique catastrophe. Un ruisseau large d’une vingtaine de pieds me barrait le chemin ; j’en longeai le bord sur une petite distance, cherchant un endroit où le franchir à pied sec. Enfin j’avisai en son milieu une grosse pierre plate que la force du courant avait détachée et roulée jusque-là. Pour l’atteindre, il suffisait d’une enjambée. Malheureusement, la pierre était taillée de telle sorte que, trop lourde du haut, elle bascula quand je m’y posai, me précipitant dans l’eau glaciale. Ma bougie s’éteignit, je restai à barboter en pleines ténèbres.
Tant bien que mal, je me relevai, moins alarmé qu’amusé. La bougie, tombée de ma main, s’en était allée au ruisseau, mais j’en avais deux autres dans ma poche, l’incident n’avait donc pas d’importance. J’en pris une, je m’apprêtai à l’allumer ; et seulement alors je me rendis compte de ma situation. Mon plongeon avait été fatal à mes allumettes, elles résistèrent à tous les grattages.
J’eus l’impression qu’une main m’étreignait le cœur. Autour de moi, la nuit était impénétrable, horrible, telle qu’on était tenté d’élever la main devant soi pour écarter quelque chose de solide. Je demeurai immobile, m’efforçant à reprendre courage. J’essayai de refaire dans ma pensée le plan de la caverne d’après la dernière vision que j’en avais eue. Hélas ! les seuls repères qui se fussent gravés dans ma mémoire étaient des particularités de la muraille trop haut placées pour que ma main les retrouvât. Pourtant, je me rappelai d’une façon générale la position des côtés ; en me dirigeant à tâtons, peut-être parviendrais-je jusqu’à l’ouverture de la galerie romaine. Et je me mis en marche pas à pas, frappant sans cesse le roc, en quête de mon issue.
Mais je ne tardai pas à concevoir le chimérique de mon entreprise. Dans cette obscurité épaisse et molle, on perdait instantanément sa direction. Je n’avais pas fait une douzaine de pas que déjà je ne savais plus où j’étais. Le ruisseau m’informait de son voisinage par son murmure, qui était le seul bruit perceptible ; mais à peine en quittais-je le bord, j’étais entièrement perdu. Évidemment, je ne pouvais espérer de me reconnaître dans cette nuit, au fond de ce dédale.
Je m’assis, pour réfléchir, sur un bloc de rocher. Je n’avais dit à personne mon intention de visiter la mine de Blue John ; il n’y avait donc point d’apparence qu’on m’y cherchât, et, pour me tirer de ce danger, je n’avais à compter que sur moi-même. Mon seul espoir, c’était d’arriver à sécher mes allumettes. En tombant dans l’eau, je n’avais pas pris un bain complet, mon épaule gauche avait échappé à l’immersion. Je plaçai, en conséquence, ma boîte d’allumettes sous mon aisselle gauche. Ma chaleur naturelle pouvait neutraliser l’humidité de la caverne. Mais dans cette éventualité même je savais ne pouvoir obtenir de lumière avant plusieurs heures ; je n’avais rien à faire que de patienter.
Heureusement, avant de quitter la ferme, j’avais fourré dans ma poche quelques biscuits. Je les dévorai, les arrosant d’un peu d’eau du malencontreux ruisseau, cause de mes infortunes. Puis je cherchai parmi les rocs un siège confortable ; et quand j’eus découvert un endroit qui m’offrît un appui pour le dos, j’allongeai les jambes et m’installai pour attendre. J’étais tout trempé, tout transi ; mais je me remontai en pensant que la science moderne prescrit pour ma maladie les fenêtres ouvertes et la marche par tous les temps. Petit à petit, assoupi par le gargouillement monotone du ruisseau et par la nuit environnante, je tombai dans un pénible sommeil.
Combien de temps je dormis, je l’ignore. Peut-être une heure, peut-être plusieurs. Soudain je me dressai sur mon séant, tous les sens en alerte ; sans aucun doute j’avais entendu un bruit, un bruit parfaitement distinct de celui des eaux. Il avait cessé, mais je croyais l’entendre encore. Était-on à ma recherche ? Dans ce cas, on eût certainement crié, et, si vague que fût le bruit qui m’avait réveillé, il ne rappelait nullement la voix humaine. J’écoutai, palpitant, osant à peine respirer. Et voilà qu’une deuxième fois le bruit se fit entendre. Puis une troisième. Bientôt, il devint continu. C’était un bruit de pas : oui, sûrement, le bruit du pas d’une créature vivante. Mais quel pas ! Il donnait l’impression d’une masse énorme, portée sur des pieds qui auraient pu être faits d’étoupe, et dont le son, tout assourdi qu’il était, emplissait cependant l’oreille. L’ombre était toujours aussi dense, mais les pas étaient réguliers, décidés. Et pas d’erreur possible, ils se dirigeaient vers moi.
Ma chair se glaça, mes cheveux se hérissèrent, tandis que j’écoutais cette marche ferme et pesante. Il y avait là un animal. Mais lequel ? La vitesse de son avance prouvait qu’il voyait clair dans le noir. Je me blottis, je m’écrasai contre mon rocher, j’aurais voulu m’y confondre. Les pas se rapprochaient toujours. Puis j’entendis des lapements, des glouglous sonores ; la bête buvait au ruisseau. Puis, de nouveau, il se fit un silence, coupé de reniflements, de ronflements prolongés, formidables par l’énergie et le volume. Étais-je éventé ? Une odeur méphitique m’emplissait les narines. Le bruit de pas recommença. La bête avait franchi le ruisseau. À quelques yards de moi, la pierre résonnait lourdement. Je m’aplatis encore davantage contre mon rocher. Je soufflais à peine. Enfin les pas s’éloignèrent, un grand clapotement m’apprit que la bête retraversait le ruisseau, le bruit de pas décrût au loin, dans la direction d’où il était vertu.
Je restai un bon moment étendu sur le roc, paralysé d’horreur. Je songeai à l’espèce de cri que j’avais entendu s’élever du fond de la caverne, aux craintes d’Armitage, à l’empreinte singulière marquée dans la boue. De surcroît, j’avais maintenant cette preuve décisive, irrécusable, qu’il existait, dans le creux de la montagne, un monstre inconcevable et redoutable, comme n’en connaît point la surface de la terre. Rien ne m’en faisait soupçonner la nature ni la forme ; je présumai seulement qu’il avait une façon légère de poser le pied et qu’il était gigantesque. Un combat furieux se livrait entre ma raison, me disant qu’une pareille chose ne pouvait être, et mes sens, m’affirmant qu’elle était. Pour un peu, je me serais cru le jouet d’un mauvais rêve, la dupe d’une hallucination engendrée par une situation aussi anormale que la mienne. Une dernière aventure fixa mes esprits.
J’avais retiré mes allumettes de dessous mon aisselle. Je les touchai, elles semblaient parfaitement sèches et dures. Penchant le corps dans l’intérieur d’une crevasse, j’en essayai une ; à ma grande joie, elle prit feu aussitôt. J’allumai ma bougie, et, jetant un regard de terreur derrière moi dans les ombres de la caverne, je me hâtai vers la galerie romaine. Chemin faisant, je passai devant la flaque de boue au milieu de laquelle j’avais aperçu l’énorme empreinte. Et je m’arrêtai confondu d’étonnement : la flaque portait, cette fois, trois empreintes similaires, non moins énormes, d’un dessin irrégulier, d’une profondeur trahissant la pesée d’une masse. La terreur m’envahit. Inclinant ma bougie et la voilant avec la main, je pris une course effrénée vers la sortie, je gravis, de toute la vitesse de mes jambes, la rampe pierreuse montant vers l’arche, et je ne fis halte que lorsque, pantelant, me soutenant à peine, je fus repassé à travers le fouillis des ronces. Alors, épuisé, je me jetai sur l’herbe, à la clarté pacifique des étoiles. Il était, quand je rentrai à la ferme, trois heures du matin. Tout cela m’a démoli ; aujourd’hui encore, je tremble en y repensant. Je n’en ai soufflé mot à qui que ce soit. La prudence s’impose. Que feraient, si je parlais, deux pauvres femmes seules ou des rustres mal dégrossis ? J’ai besoin de trouver quelqu’un qui me comprenne et me conseille.
25 avril. – Je suis resté deux jours au lit après mon incroyable aventure de la caverne. Quand je dis incroyable, c’est à dessein, car il m’est arrivé, depuis, quelque chose qui m’a presque bouleversé. Je songeais, écrivais-je plus haut, à trouver quelqu’un pour me conseiller. J’avais justement un mot de recommandation du professeur Saunderson pour un certain docteur Mark Johnson qui exerce à quelques milles d’ici. Dès que je me sentis assez fort pour sortir, je me fis porter chez lui et le mis au courant de tout. Il m’écouta des deux oreilles, m’examina fort soigneusement, prêta une attention particulière à mes réflexes et aux pupilles de mes yeux. D’ailleurs, quand j’eus terminé mon récit, il refusa de discuter, motif pris de son incompétence ; mais il me donna la carte d’un M. Picton, de Castleton, en m’engageant à l’aller voir tout de suite et à lui raconter mon histoire comme je venais de la raconter à lui-même. C’était, me disait-il, un homme éminemment qualifié pour m’assister. Je me rendis donc à la gare, où je pris le train pour la petite ville de Castleton, distante d’une dizaine de milles. M. Picton devait être un homme d’importance, à en juger par celle de l’immeuble qu’il occupait aux abords de la ville, et sur la porte duquel s’étalait une plaque de cuivre à son nom. J’allais sonner, quand, pris d’une subite méfiance, je traversai la rue, j’entrai dans une boutique voisine et demandai au boutiquier s’il pouvait me renseigner sur M. Picton. « C’est, me dit-il, le meilleur médecin aliéniste du Derbyshire ; et, tenez, voilà son asile. » On imagine que je ne fus pas long à secouer de mes souliers la poussière de Castleton et à m’en revenir à la ferme, maudissant les pédants sans imagination, incapables de se faire à l’idée qu’il puisse y avoir dans la nature des choses que n’ont point aperçues leurs yeux de taupes. Après tout, maintenant que j’ai recouvré mon sang-froid, j’accorde volontiers que je n’ai pas su avoir, pour les propos d’Armitage, plus de complaisance que le docteur Johnson pour les miens.
27 avril. – Du temps que j’étais étudiant, on vantait mon initiative et mon courage. C’est moi qui m’installai dans la maison hantée de Coltbridge quand il s’agit d’y relancer un fantôme. Aurais-je dégénéré avec l’âge (en somme, je n’ai que trente-trois ans) ou avec la maladie ? Le cœur me manque chaque fois que, songeant à l’horrible caverne de la colline, je me répète avec certitude qu’elle a un monstrueux habitant. Que faire ? Il n’y a pas une heure du jour où je ne débatte cette question. Si je me tais, le mystère persiste ; si je parle, je risque ou d’alarmer follement le pays, ou de me heurter à l’incrédulité générale, et par là, peut-être, m’exposer à l’internement dans un asile. Je crois qu’en définitive le mieux est d’attendre, tout en préparant une expédition plus réfléchie, plus mûrie que la première. Pour commencer, je suis allé à Castleton, où je me suis muni de quelques objets essentiels, par exemple une lanterne à acétylène et un bon fusil de chasse à deux coups. J’ai simplement loué le fusil, mais j’ai acheté une douzaine de cartouches pour gros gibier, qui abattraient un rhinocéros. Me voilà paré pour affronter l’aimable troglodyte. Qu’avec une meilleure santé je reprenne un peu de ressort, et j’essaierai de savoir à quoi m’en tenir sur son compte. Mais qui est-il ? Qu’est-il ? Ah ! parbleu, c’est la question. Elle m’obsède. Je n’en dors plus. Que d’hypothèses j’ai faites, pour les écarter l’une après l’autre ! Tout cela est inconcevable ; et pourtant, le cri, les empreintes de pieds, le bruit de pas dans la caverne… autant de faits contre quoi nul raisonnement ne saurait prévaloir. Je pense aux dragons et autres monstres des légendes antiques : est-ce que, par hasard, ils avaient une réalité secrète, qu’entre tous les mortels j’aurais la mission de déceler ?
3 mai. – Ces derniers jours, tandis que les caprices d’un printemps anglais me condamnaient à garder la chambre, il est survenu divers incidents dont nul que moi n’est en mesure de comprendre la signification exacte et sinistre. Nous venons d’avoir une de ces périodes de nuits couvertes et sans lune qui, d’après mes renseignements coïncident d’ordinaire avec les disparitions de moutons. Eh bien, des moutons ont encore disparu : deux du troupeau de Miss Allerton, un chez le vieux Pearson, au Cat Walk, un chez M. Moulton. Quatre, au total, en trois nuits. On n’en a retrouvé aucune trace. Il n’est bruit dans le pays que de bohémiens et de rôdeurs.
Mais voici qui est plus grave : le jeune Armitage a, lui aussi, disparu. Il a quitté mercredi, de bon matin, son cottage de la lande, et depuis lors on n’a plus de ses nouvelles. Comme il est sans famille, l’événement n’a causé qu’une émotion relative. La rumeur publique, c’est qu’il doit de l’argent, qu’il se sera procuré quelque part une situation et qu’il ne tardera pas à écrire pour se faire envoyer ses nippes. Mais j’ai de sérieuses appréhensions. N’est-il pas plus croyable qu’à la suite des récents dommages subis par les troupeaux il aura pris certaines mesures qui lui auront été funestes ? Est-ce que, par exemple, ayant voulu guetter le monstre, il n’aura pas été emporté par lui dans les réduits de la montagne ? Extraordinaire destinée pour un Anglais civilisé du XXe siècle ! Et néanmoins, je la sens non seulement possible, mais probable. Jusqu’à quel point, dans ce cas, porté-je la responsabilité de cette mort, et de tous les autres malheurs qui menacent de se produire ? Sachant ce que je sais, j’ai, à coup sûr, le droit d’intervenir pour qu’on fasse quelque chose, ou d’agir moi-même, s’il est nécessaire. Au reste, c’est à ce dernier parti qu’il faut que je m’arrête ; car ce matin je suis allé au bureau de la police locale, j’y ai raconté mon histoire, l’Inspecteur l’a consignée dans un grand registre, après quoi il m’a salué avec la plus louable gravité. Mais je n’avais pas plus tôt repassé dans son jardin que j’ai entendu des éclats de rire : évidemment, il faisait part de ma déclaration à sa famille.
10 juin. – Six semaines que je n’ai touché à ce journal. C’est dans mon lit, et soulevé sur un appui, que je trace ces lignes. Je sors, également ébranlé dans mon esprit et dans mon corps, d’une aventure comme il n’en échoit pas souvent à un homme. Mais je suis parvenu à mes fins. Le monstre qui habitait la Brèche de Blue John a cessé pour jamais d’être un danger. Ce résultat si heureux pour tout le monde, j’y ai particulièrement contribué, moi malade. Tâchons de dire aussi clairement que possible comment la chose s’est passée.
La nuit du vendredi 3 mai était noire, chargée de nuages, faite à souhait, en vérité, pour une sortie du monstre. Vers onze heures, je quittai la ferme, emportant ma lanterne à acétylène et le fusil de chasse à deux coups que j’avais loué quelques jours auparavant. J’avais laissé sur la table de ma chambre un bout de lettre où je demandais que, si je ne reparaissais pas, on me cherchât du côté de la brèche. Je m’acheminai vers l’ouverture du puits romain ; là, me juchant sur les rocs qui l’avoisinent, j’éteignis ma lanterne ; et j’attendis ensuite avec patience, mon fusil à la main, prêt à faire feu.
Mélancolique veillée d’armes. Tout le long de la vallée sinueuse, j’apercevais les lumières éparses des fermes ; l’horloge de l’église de Chapel-le-Dale me tintait faiblement les heures. Ces signes de la présence humaine ne faisaient que me rendre plus vif le sentiment de ma solitude ; j’avais besoin d’un grand effort pour dominer ma terreur, pour ne pas céder à la tentation de regagner la ferme et d’en rester là de ma périlleuse entreprise. Mais l’homme porte, enraciné dans le cœur, un respect de soi qui le prémunit contre certaines renonciations, et qui m’empêcha de quitter la place quand l’instinct m’y conviait. Je m’en réjouis aujourd’hui : quoi qu’il m’en coûte, ma dignité d’homme est sauve.
Minuit sonna au clocher de l’église lointaine, puis une heure, puis deux. La nuit n’avait jamais été plus sombre. Les nuages couraient bas dans le ciel, il n’y avait pas une étoile. Un hibou rôdait quelque part dans les rochers ; sauf les soupirs du vent, aucun bruit ne venait à mes oreilles.
Et soudain, j’entendis. J’entendis, du fin fond de la galerie, venir ces pas assourdis, si feutrés et si massifs tout ensemble ! J’entendis le bruit des pierres déplacées par cette masse géante. Les pas venaient vers moi. Bientôt ils furent tout proches. J’entendis craquer la broussaille autour de l’entrée ; et vaguement, à travers les ténèbres, je vis une silhouette colossale, une monstrueuse et rudimentaire créature, se mouvoir lentement, silencieusement, au dehors. La stupeur non moins que la peur figeait mes membres. Si longtemps que j’eusse attendu, je n’étais point préparé à une telle secousse. Je demeurai immobile, hors d’haleine, tandis que la grande masse confuse passait, me rasant presque, pour s’enfoncer dans la nuit.
Mais j’essayai de prendre sur moi pour son retour. Aucun bruit qui réveillât la campagne endormie ne dénonçait la présence du monstre. Je n’avais aucun moyen de juger à quelle distance il était, ni ce qu’il faisait, ni quand il reviendrait. Mais je ne permettrais pas à mes nerfs de me trahir une seconde fois, je ne le laisserais pas une seconde fois passer impunément : je m’en fis la promesse solennelle à moi-même, tandis que, les dents serrées, je disposais mon fusil tout armé au-dessus du roc.
L’événement se produisit très vite. La bête marchant sur l’herbe, rien ne m’avertit de son approche. Soudain, comme une ombre titubante, la masse énorme se redessina devant moi. Elle cherchait l’entrée de la caverne. Une nouvelle paralysie de la volonté cloua mon doigt impuissant contre la gâchette. Mais dans un effort désespéré je me secouai. Au moment où, froissant la broussaille, le monstre allait se perdre dans les ténèbres de la brèche, je tirai sur lui par derrière. À la lueur du coup de feu, j’eus le temps d’entrevoir un grand corps velu, au poil rude et hérissé, d’une couleur grise qui, dans les parties basses, tirait sur le noir ; deux courtes pattes, épaisses et cagneuses, supportaient cette formidable charpente. La vision s’effaça tout de suite, j’entendis les cailloux dégringoler, l’animal se jetait dans son antre. Aussitôt, un revirement victorieux se faisant en moi, je jetai toute crainte au vent, je démasquai ma puissante lanterne, et, le fusil en main, bondissant de mon rocher, je m’élançai dans le vieux puits, sur les pas du monstre.
Ma lampe projetait devant moi un faisceau magnifique, bien différent de la pauvre lueur jaune qui avait, deux jours auparavant, guidé ma descente. Tout en courant, je voyais à peu de distance le gigantesque animal se sauver, en roulant d’un côté à l’autre, et peu s’en fallait qu’il n’occupât de sa largeur tout l’espace entre les deux murailles. Son poil semblait fait d’une grosse étoupe décolorée, qui pendait en longs filaments compacts balancés par la marche ; cette toison lui donnait l’air d’un énorme mouton avant la tonte ; mais il était de dimensions bien supérieures à celles du plus gros éléphant, et sa largeur égalait presque sa hauteur. Je ne reviens pas de mon étonnement, aujourd’hui, en songeant que j’ai osé m’enfoncer sous la terre à la poursuite d’un tel monstre ; mais quand le sang est échauffé, quand la proie convoitée semble fuir, l’esprit chasseur des premiers âges se réveille, adieu toute prudence ! Le fusil au poing, je courais de plus en plus vite sur les traces de l’animal.
J’avais pu m’apercevoir qu’il était agile, j’allais apprendre à mes dépens combien il était rusé. Le croyant fou de peur, je me figurais n’avoir qu’à le poursuivre ; l’idée qu’il pût se retourner n’avait même pas effleuré mon cerveau surexcité. J’ai dit que le couloir que je descendais s’ouvrait sur une immense caverne centrale : j’y fis littéralement irruption, craignant de me laisser dépister. Mais l’animal avait rebroussé chemin ; l’instant d’après, nous nous trouvions face à face.
La scène, telle qu’elle m’apparut dans le rayonnement blanc de ma lanterne, s’est gravée pour toujours dans ma mémoire. L’animal s’était dressé à la façon d’un ours sur ses pattes de derrière, et il me dominait, menaçant, formidable : le pire cauchemar n’en avait point évoqué de pareil dans mon imagination. Il grognait comme un ours ; et si l’on peut concevoir un ours ayant dix fois la proportion de ceux qu’on a jamais vus à la surface du sol, c’est encore un ours qu’il rappelait par sa pose, par toute son attitude, avec ses pattes de devant repliées, ses griffes d’ivoire, son poil hérissé, sa gueule rouge béante, bordée de crocs monstrueux. En un point seulement, il différait de l’ours, comme de toute autre bête vivant sur la terre ; et même à cette minute suprême un frisson d’horreur me traversa quand j’observai que ses yeux, reluisants sous le feu de ma lanterne, étaient d’énormes globes à fleur de tête, tout blancs et sans vie. Un moment, ses deux grandes pattes s’agitèrent au-dessus de mon front, puis il se pencha, je tombai sur le sol, ma lanterne vola en éclats, je perdis connaissance.
Quand je revins à moi, j’étais à la ferme des Allerton. Deux jours avaient passé depuis mon effroyable rencontre de la brèche. Il semble que je sois resté toute la nuit étendu sur le sol de la caverne, inanimé, par suite d’une violente commotion au cerveau. On avait, le matin, trouvé mon petit mot ; une douzaine de fermiers étaient partis à ma recherche ; mes traces relevées jusqu’à l’endroit où je gisais, on m’avait transporté dans ma chambre, où, depuis, j’étais couché, dans le délire de la fièvre. Il paraît qu’on n’avait découvert aucun signe du monstre, pas la moindre tache de sang qui indiquât que ma balle eût porté quand j’avais tiré à son passage. Sauf la piteuse condition où j’étais et les empreintes marquées dans la boue, il n’y avait rien pour prouver la sincérité de mes allégations. Six semaines se sont écoulées ; et me voilà de nouveau dehors, assis au soleil. En face de moi, la colline étage ses escarpements de schiste grisâtre ; j’aperçois à son flanc l’entaille noire qui marque l’entrée de la Brèche de Blue John. Mais elle ne saurait plus être un sujet d’épouvante ; de cette galerie fatale, aucun monstre ignoré ne se glissera plus dans le monde des humains. Que les gens instruits et les savants, que le Dr Johnson et ses pareils sourient de mon récit, les paysans d’ici ne l’ont pas un instant révoqué en doute. Le jour même où je reprenais conscience, ils s’étaient rassemblés par centaines autour de la Brèche de Blue John. Et, comme dit le Courrier de Castleton :
« En vain notre correspondant, en vain les aventureux gentlemen venus de Matlock, Buxton et autres lieux, offrirent de descendre pour explorer la caverne et vérifier une fois pour toutes l’extraordinaire récit du Dr James Hardcastle : les gens du pays avaient pris l’affaire en mains, et depuis la première heure du matin ils étaient à l’œuvre pour boucher l’entrée du tunnel. Il y a une pente raide à l’endroit où le puits commence, ce fut à qui roulerait les blocs de rochers pour les y précipiter, jusqu’à ce qu’on eût complètement muré la brèche. Ainsi finit cette histoire, qui a causé dans les alentours une si vive sensation. L’opinion locale est profondément divisée à son sujet. D’une part, on fait ressortir le mauvais état de santé du Dr Hardcastle, la possibilité de lésions cérébrales d’origine tuberculeuse, donnant naissance à d’étranges hallucinations : quelque idée fixe aurait, d’après cette thèse, amené le docteur à descendre dans la galerie, et une chute sur les rocs expliquerait suffisamment ses blessures. À quoi l’on répond d’autre part qu’il s’était formé, plusieurs mois avant, une légende relative à l’existence d’une bête inconnue dans la brèche, et qu’aux yeux des fermiers le récit du Dr Hardcastle et l’aspect de ses blessures la confirment de façon décisive. La question en est là, et en restera là, car il ne semble plus permis d’espérer une solution déterminée ; les faits allégués échappent à toute explication scientifique. »
Peut-être, avant d’imprimer cette dernière phrase, le Courrier eût-il bien fait de m’envoyer un représentant. J’ai médité le problème mieux que personne ; il n’est pas dit que je n’aurais pas justifié les points les plus évidemment contestables de mon récit, et que je ne les aurais pas rendus plus acceptables pour la science. Je ne vois qu’une explication susceptible d’éclairer une série de faits que j’ai trop lieu de tenir pour réels, m’en étant assuré à mon préjudice. On la taxera, si l’on veut, d’extravagance, nul n’est en droit d’en affirmer l’impossibilité.
Mon opinion, – et qui était faite, ce journal en témoigne, avant qu’il me fût rien arrivé, – c’est qu’il existe, dans cette région de l’Angleterre, une vaste nappe d’eau ou une mer souterraine, alimentée par les nombreuses sources qui descendent à travers le calcaire. Là où des eaux abondantes se réunissent, il doit y avoir quelque évaporation, sous forme de brouillards ou de pluies, et quelque végétation. Ceci donne lieu de croire qu’il peut s’y trouver aussi une vie animale, laquelle proviendrait, comme la vie végétale, de semences et de types introduits à une époque très lointaine de l’histoire du monde, alors que les communications avec le dehors étaient plus aisées. Cette place a donc vu se développer une faune et une flore particulières, comprenant des monstres comme le mien, qui peut fort bien être l’ancien ours des cavernes, considérablement agrandi et modifié par son nouveau milieu. Durant d’incalculables millénaires, la création intérieure et la création extérieure sont restées indépendantes l’une de l’autre, chacune s’élaborant de son côté ; puis il s’est fait, dans les profondeurs de la terre, une crevasse par où la bête a pu monter vers le sol et, grâce à la galerie romaine, atteindre le plein air. Comme il arrive dans toute vie souterraine, la bête a perdu l’usage de la vue ; mais la nature ne l’a certainement pas laissée sans compensations. Il n’est point douteux qu’elle ait le moyen de reconnaître son chemin ou de faire la chasse aux troupeaux sur les collines. Si elle choisissait de préférence les nuits sombres, c’est, à mon sens, que la lumière était pénible à ses grandes prunelles blanches et qu’elles ne pouvaient supporter que l’obscurité absolue. Peut-être la vive clarté de ma lanterne m’a-t-elle sauvé la vie à la minute tragique où nous nous trouvâmes face à face. Tel est, ce me semble, le mot de l’énigme.
Je laisse derrière moi cet exposé des faits ; si l’on peut les expliquer, qu’on le fasse. Si l’on préfère en douter, soit ! Que l’on en doute ou que l’on y croie, on n’y changera rien, et peu importe à un homme qui est bien près d’avoir fini sa tâche.
Ainsi se termine le curieux récit du Dr James Hardcastle.
Source: https://ebooks-bnr.com/doyle-arthur-conan-la-breche-au-monstre/