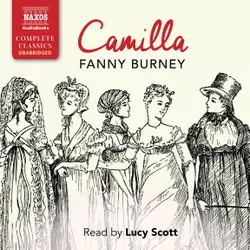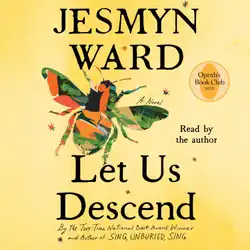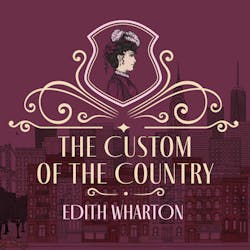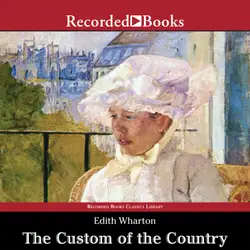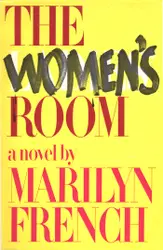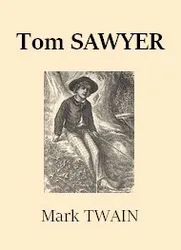LES ORANGES
fantaisie.
À Paris, les oranges ont l’air triste de fruits tombés ramassés sous l’arbre. À l’heure où elles vous arrivent, en plein hiver pluvieux et froid, leur écorce éclatante, leur parfum exagéré dans ces pays de saveurs tranquilles, leur donnent un aspect étrange, un peu bohémien. Par les soirées brumeuses, elles longent tristement les trottoirs, entassées dans leurs petites charrettes ambulantes, à la lueur sourde d’une lanterne en papier rouge. Un cri monotone et grêle les escorte, perdu dans le roulement des voitures, le fracas des omnibus :
— À deux sous la Valence !
Pour les trois quarts des Parisiens, ce fruit cueilli au loin, banal dans sa rondeur, où l’arbre n’a rien laissé qu’une mince attache verte, tient de la sucrerie, de la confiserie. Le papier de soie qui l’entoure, les fêtes qu’il accompagne, contribuent à cette impression. Aux approches de janvier surtout, les milliers d’oranges disséminées par les rues, toutes ces écorces traînant dans la boue du ruisseau, font songer à quelque arbre de Noël gigantesque qui secouerait sur Paris ses branches chargées de fruits factices. Pas un coin où on ne les rencontre. À la vitrine claire des étalages, choisies et parées ; à la porte des prisons et des hospices, parmi les paquets de biscuits, les tas de pommes ; devant l’entrée des bals, des spectacles du dimanche. Et leur parfum exquis se mêle à l’odeur du gaz, au bruit des crincrins, à la poussière des banquettes du paradis. On en vient à oublier qu’il faut des orangers pour produire les oranges, car pendant que le fruit nous arrive directement du Midi à pleines caisses, l’arbre, taillé, transformé, déguisé, de la serre chaude où il passe l’hiver, ne fait qu’une courte apparition au plein air des jardins publics.
Pour bien connaître les oranges, il faut les avoir vues chez elles, aux îles Baléares, en Sardaigne, en Corse, en Algérie, dans l’air bleu doré, l’atmosphère tiède de la Méditerranée. Je me rappelle un petit bois d’orangers, aux portes de Blidah ; c’est là qu’elles étaient belles ! Dans le feuillage sombre, lustré, vernissé, les fruits avaient l’éclat de verres de couleur, et doraient l’air environnant avec cette auréole de splendeur qui entoure les fleurs éclatantes. Çà et là des éclaircies laissaient voir à travers les branches les remparts de la petite ville, le minaret d’une mosquée, le dôme d’un marabout, et au-dessus l’énorme masse de l’Atlas, verte à sa base, couronnée de neige comme d’une fourrure blanche, avec des moutonnements, un flou de flocons tombés.
Une nuit, pendant que j’étais là, je ne sais par quel phénomène ignoré depuis trente ans cette zone de frimas et d’hiver se secoua sur la ville endormie, et Blidah se réveilla transformée, poudrée à blanc. Dans cet air algérien si léger, si pur, la neige semblait une poussière de nacre. Elle avait des reflets de plumes de paon blanc. Le plus beau, c’était le bois d’orangers. Les feuilles solides gardaient la neige intacte et droite comme des sorbets sur des plateaux de laque, et tous les fruits poudrés à frimas avaient une douceur splendide, un rayonnement discret comme de l’or voilé de claires étoffes blanches. Cela donnait vaguement l’impression d’une fête d’église, de soutanes rouges sous des robes de dentelles, de dorures d’autel enveloppées de guipures…
Mais mon meilleur souvenir d’oranges me vient encore de Barbicaglia, un grand jardin auprès d’Ajaccio où j’allais faire la sieste aux heures de chaleur. Ici les orangers, plus hauts, plus espacés qu’à Blidah, descendaient jusqu’à la route, dont le jardin n’était séparé que par une haie vive et un fossé. Tout de suite après, c’était la mer, l’immense mer bleue… Quelles bonnes heures j’ai passées dans ce jardin ! Au-dessus de ma tête, les orangers en fleur et en fruit brûlaient leurs parfums d’essences. De temps en temps, une orange mûre, détachée tout à coup, tombait près de moi comme alourdie de chaleur, avec un bruit mat, sans écho, sur la terre pleine. Je n’avais qu’à allonger la main. C’étaient des fruits superbes, d’un rouge pourpre à l’intérieur. Ils me paraissaient exquis, et puis l’horizon était si beau ! Entre les feuilles, la mer mettait des espaces bleus éblouissants comme des morceaux de verre brisés qui miroitaient dans la brume de l’air. Avec cela le mouvement du flot agitant l’atmosphère à de grandes distances, ce murmure cadencé qui vous berce comme dans une barque invisible, la chaleur, l’odeur des oranges... Ah ! qu’on était bien pour dormir dans le jardin de Barbicaglia !
Quelquefois cependant, au meilleur moment de la sieste, des éclats de tambour me réveillaient en sursaut. C’étaient de malheureux tapins qui venaient s’exercer en bas, sur la route. À travers les trous de la haie, j’apercevais le cuivre des tambours et les grands tabliers blancs sur les pantalons rouges. Pour s’abriter un peu de la lumière aveuglante que la poussière de la route leur renvoyait impitoyablement, les pauvres diables venaient se mettre au pied du jardin, dans l’ombre courte de la haie. Et ils tapaient ! et ils avaient chaud ! Alors, m’arrachant de force à mon hypnotisme, je m’amusais à leur jeter quelques-uns de ces beaux fruits d’or rouge qui pendaient près de ma main. Le tambour visé s’arrêtait. Il y avait une minute d’hésitation, un regard circulaire pour voir d’où venait la superbe orange roulant devant lui dans le fossé ; puis il la ramassait bien vite et mordait à pleines dents sans même enlever l’écorce.
Je me souviens aussi que tout à côté de Barbicaglia, et séparé seulement par un petit mur bas, il y avait un jardinet assez bizarre que je dominais de la hauteur où je me trouvais. C’était un petit coin de terre bourgeoisement dessiné. Ses allées blondes de sable, bordées de buis très vert, les deux cyprès de sa porte d’entrée, lui donnaient l’aspect d’une bastide marseillaise. Pas une ligne d’ombre. Au fond, un bâtiment de pierre blanche avec des jours de caveau au ras du sol. J’avais d’abord cru à une maison de campagne ; mais, en y regardant mieux, la croix qui la surmontait, une inscription que je voyais de loin creusée dans la pierre, sans en distinguer le texte, me firent reconnaître un tombeau de famille corse. Tout autour d’Ajaccio, il y a beaucoup de ces petites chapelles mortuaires, dressées au milieu de jardins à elles seules. La famille y vient, le dimanche, rendre visite à ses morts. Ainsi comprise, la mort est moins lugubre que dans la confusion des cimetières. Des pas amis troublent seuls le silence.
De ma place, je voyais un bon vieux trottiner tranquillement par les allées. Tout le jour il taillait les arbres, bêchait, arrosait, enlevait les fleurs fanées avec un soin minutieux ; puis, au soleil couchant, il entrait dans la petite chapelle où dormaient les morts de sa famille ; il resserrait la bêche, les râteaux, les grands arrosoirs ; tout cela avec la tranquillité, la sérénité d’un jardinier de cimetière. Pourtant, sans qu’il s’en rendît bien compte, ce brave homme travaillait avec un certain recueillement, tous les bruits amortis et la porte du caveau refermée, chaque fois discrètement comme s’il eût craint de réveiller quelqu’un. Dans le grand silence radieux, l’entretien de ce petit jardin ne troublait pas un oiseau, et son voisinage n’avait rien d’attristant. Seulement la mer en paraissait plus immense, le ciel plus haut, et cette sieste sans fin mettait tout autour d’elle, parmi la nature troublante, accablante à force de vie, le sentiment de l’éternel repos…
À MILIANAH.
NOTES DE VOYAGE.
Cette fois, je vous emmène passer la journée dans une jolie petite ville d’Algérie, à deux ou trois cents lieues du moulin… Cela nous changera un peu des tambourins et des cigales…
… Il va pleuvoir ; le ciel est gris, les crêtes du mont Zaccar s’enveloppent de brume. Dimanche triste… Dans ma petite chambre d’hôtel, la fenêtre ouverte sur les remparts arabes, j’essaye de me distraire en allumant des cigarettes… On a mis à ma disposition toute la bibliothèque de l’hôtel ; entre une histoire très détaillée de l’enregistrement et quelques romans de Paul de Kock je découvre un volume dépareillé de Montaigne… Ouvert le livre au hasard, relu l’admirable lettre sur la mort de La Boétie… Me voilà plus rêveur et plus sombre que jamais... Quelques gouttes de pluie tombent déjà. Chaque goutte, en tombant sur le rebord de la croisée, fait une large étoile dans la poussière entassée là depuis les pluies de l’an dernier… Mon livre me glisse des mains, et je passe de longs instants à regarder, cette étoile mélancolique…
Deux heures sonnent à l’horloge de la ville, un ancien marabout dont j’aperçois d’ici les grêles murailles blanches… Pauvre diable de marabout ! Qui lui aurait dit cela, il y a trente ans, qu’un jour il porterait au milieu de la poitrine un gros cadran municipal, et que, tous les dimanches, sur le coup de deux heures, il donnerait aux églises de Milianah le signal de sonner les vêpres ?… Ding ! dong ! voilà les cloches parties !… Nous en avons pour longtemps… Décidément, cette chambre est triste. Les grosses araignées du matin, qu’on appelle pensées philosophiques, on tissé leurs toiles dans tous les coins… Allons dehors.
J’arrive sur la grande place. La musique du 3e de ligne, qu’un peu de pluie n’épouvante pas, vient de se ranger autour de son chef. À une des fenêtres de la division, le général paraît, entouré de ses demoiselles ; sur la place le sous-préfet se promène de long en large au bras du juge de paix. Une demi-douzaine de petits Arabes, à moitié nus, jouent aux billes dans un coin avec des cris féroces. Là-bas, un vieux juif en guenilles vient chercher un rayon de soleil qu’il avait laissé hier à cet endroit et qu’il s’étonne de ne plus trouver… « Une, deux, trois, partez ! » La musique entonne une ancienne mazurka de Talexy, que les orgues de Barbarie jouaient l’hiver dernier sous mes fenêtres. Cette mazurka m’ennuyait autrefois ; aujourd’hui elle m’émeut jusqu’aux larmes.
Oh ! comme ils sont heureux les musiciens du 3e ! L’œil fixé sur les doubles croches, ivres de rythme et de tapage, ils ne songent à rien qu’à compter leurs mesures. Leur âme, toute leur âme tient dans ce carré de papier large comme la main, — qui tremble au bout de l’instrument entre deux dents de cuivre. « Une, deux, trois, partez ! » Tout est là pour ces braves gens ; jamais les airs nationaux qu’ils jouent ne leur ont donné le mal du pays… Hélas ! moi qui ne suis pas de la musique, cette musique me fait peine, et je m’éloigne…
Où pourrais-je bien la passer, cette grise après-midi de dimanche ? Bon ! la boutique de Sid’Omar est ouverte… Entrons chez Sid’Omar.
Quoiqu’il ait une boutique, Sid’Omar n’est point un boutiquier. C’est un prince du sang, le fils d’un ancien dey d’Alger qui mourut étranglé par les janissaires… À la mort de son père, Sid’Omar se réfugia dans Milianah avec sa mère qu’il adorait, et vécut là quelques années comme un grand seigneur philosophe parmi ses lévriers, ses faucons, ses chevaux et ses femmes, dans de jolis palais très frais, pleins d’orangers et de fontaines. Vinrent les Français. Sid’Omar, d’abord notre ennemi et l’allié d’Abd-el-Kader, finit par se brouiller avec l’émir et fit sa soumission. L’émir, pour se venger, entra dans Milianah en l’absence de Sid’Omar, pilla ses palais, rasa ses orangers, emmena ses chevaux et ses femmes, et fit écraser la gorge de sa mère sous le couvercle d’un grand coffre… La colère de Sid’Omar fut terrible : sur l’heure même il se mit au service de la France, et nous n’eûmes pas de meilleur ni de plus féroce soldat que lui tant que dura notre guerre contre l’émir. La guerre finie, Sid’Omar revint à Milianah ; mais encore aujourd’hui, quand on parle d’Abd-el-Kader devant lui, il devient pâle et ses yeux s’allument.
Sid’Omar a soixante ans. En dépit de l’âge et de la petite vérole, son visage est resté beau : de grands cils, un regard de femme, un sourire charmant, l’air d’un prince. Ruiné par la guerre, il ne lui reste de son ancienne opulence qu’une ferme dans la plaine du Chélif et une maison à Milianah, où il vit bourgeoisement avec ses trois fils élevés sous ses yeux. Les chefs indigènes l’ont en grande vénération. Quand une discussion s’élève, on le prend volontiers pour arbitre, et son jugement fait loi presque toujours. Il sort peu : on le trouve toutes les après-midi dans une boutique attenant à sa maison et qui ouvre sur la rue. Le mobilier de cette pièce n’est pas riche : — des murs blancs peints à la chaux, un banc de bois circulaire, des coussins, de longues pipes, deux braseros… C’est là que Sid’Omar donne audience et rend la justice. Un Salomon en boutique.
Aujourd’hui dimanche, l’assistance est nombreuse. Une douzaine de chefs sont accroupis, dans leurs beurnouss, tout autour de la salle. Chacun d’eux a près de lui une grande pipe, et une petite tasse de café dans un fin coquetier de filigrane. J’entre, personne ne bouge… De sa place, Sid’Omar envoie à ma rencontre son plus charmant sourire et m’invite de la main à m’asseoir près de lui, sur un grand coussin de soie jaune ; puis, un doigt sur les lèvres, il me fait signe d’écouter.
Voici le cas : — Le caïd des Beni-Zougzougs ayant eu quelque contestation avec un juif de Milianah au sujet d’un lopin de terre, les deux parties sont convenues de porter le différend devant Sid’Omar et de s’en remettre à son jugement. Rendez-vous est pris pour le jour même, les témoins sont convoqués ; tout à coup voilà mon juif qui se ravise, et vient, seul, sans témoins, déclarer qu’il aime mieux s’en rapporter au juge de paix des Français qu’à Sid’Omar… L’affaire en est là à mon arrivée.
Le juif — vieux, barbe terreuse, veste marron, bas bleus, casquette en velours— lève le nez au ciel, roule des yeux suppliants, baise les babouches de Sid’Omar, penche la tête, s’agenouille, joint les mains… Je ne comprends pas l’arabe, mais à la pantomime du juif, au mot : Zouge de paix, zouge de paix, qui revient à chaque instant, je devine tout ce beau discours :
— Nous ne doutons pas de Sid’Omar, Sid’Omar est sage, Sid’Omar est juste… Toutefois le zouge de paix fera bien mieux notre affaire.
L’auditoire, indigné, demeure impassible comme un Arabe qu’il est… Allongé sur son coussin, l’œil noyé, le bouquin d’ambre aux lèvres, Sid’Omar — dieu de l’ironie — sourit en écoutant. Soudain, au milieu de sa plus belle période, le juif est interrompu par un énergique caramba ! qui l’arrête net ; en même temps un colon espagnol, venu là comme témoin du caïd, quitte sa place et, s’approchant d’Iscariote, lui verse sur la tête un plein panier d’imprécations de toutes langues, de toutes couleurs, — entre autres certain vocable français trop gros monsieur pour qu’on le répète ici… Le fils de Sid’Omar, qui comprend le français, rougit d’entendre un mot pareil en présence de son père et sort de la salle. — Retenir ce trait de l’éducation arabe. — L’auditoire est toujours impassible, Sid’Omar toujours souriant. Le juif s’est relevé et gagne la porte à reculons, tremblant de peur, mais gazouillant de plus belle son éternel zouge de paix, zouge de paix… Il sort. L’Espagnol, furieux, se précipite derrière lui, le rejoint dans la rue et par deux fois — vli ! vlan ! — le frappe en plein visage… Iscariote tombe à genoux, les bras en croix... L’Espagnol, un peu honteux, rentre dans la boutique... Dès qu’il est rentré, — le juif se relève et promène un regard sournois sur la foule bariolée qui l’entoure. Il y a là des gens de tout cuir, — Maltais, Mahonais, nègres, Arabes, tous unis dans la haine du juif et joyeux d’en voir maltraiter un… Iscariote hésite un instant, puis, prenant un Arabe par le pan de son beurnouss :
— Tu l’as vu, Achmed, tu l’as vu... tu étais là... Le chrétien m’a frappé... Tu seras témoin… bien… bien… tu seras témoin.
L’Arabe dégage son beurnouss et repousse le juif… Il ne sait rien, il n’a rien vu : juste au moment, il tournait la tête…
— Mais toi, Kaddour, tu l’as vu… tu as vu le chrétien me battre… crie le malheureux Iscariote à un gros nègre en train d’éplucher une figue de Barbarie…
Le nègre crache en signe de mépris et s’éloigne, il n’a rien vu… Il n’a rien vu non plus, ce petit Maltais dont les yeux de charbon luisent méchamment derrière sa barrette ; elle n’a rien vu, cette Mahonaise au teint de brique qui se sauve en riant, son panier de grenades sur la tête…
Le juif a beau crier, prier, se démener… pas de témoin ! personne n’a rien vu… Par bonheur deux de ses coreligionnaires passent dans la rue à ce moment, l’oreille basse, rasant les murailles. Le juif les avise :
— Vite, vite, mes frères ! Vite à l’homme d’affaires ! Vite au zouge de paix !… Vous l’avez vu, vous autres... vous avez vu qu’on a battu le vieux !
S’ils l’ont vu !… Je crois bien.
…Grand émoi dans la boutique de Sid’Omar… Le cafetier remplit les tasses, rallume les pipes. On cause, on rit à belles dents. C’est si amusant de voir rosser un juif !… Au milieu du brouhaha et de la fumée, je gagne la porte doucement ; j’ai envie d’aller rôder un peu du côté d’Israël pour savoir comment les coreligionnaires d’Iscariote ont pris l’affront fait à leur frère…
— Viens dîner ce soir, moussiou, me crie le bon Sid’Omar…
J’accepte, je remercie. Me voilà dehors. Au quartier juif, tout le monde est sur pied. L’affaire fait déjà grand bruit. Personne aux échoppes. Brodeurs, tailleurs, bourreliers, — tout Israël est dans la rue… Les hommes — en casquette de velours, en bas de laine bleue — gesticulant bruyamment, par groupes… Les femmes, pâles, bouffies, raides comme des idoles de bois dans leurs robes plates à plastron d’or, le visage entouré de bandelettes noires, vont d’un groupe à l’autre en miaulant… Au moment où j’arrive, un grand mouvement se fait dans la foule. On s’empresse, on se précipite… Appuyé sur ses témoins, le juif — héros de l’aventure — passe entre deux haies de casquettes, sous une pluie d’exhortations :
— Venge-toi, frère, venge-nous, venge le peuple juif. Ne crains rien ; tu as la loi pour toi.
Un affreux nain, puant la poix et le vieux cuir, s’approche de moi d’un air piteux, avec de gros soupirs :
— Tu vois ! me dit-il. Les pauvres juifs, comme on nous traite ! C’est un vieillard ! regarde. Ils l’ont presque tué.
De vrai, le pauvre Iscariote a l’air plus mort que vif. Il passe devant moi, — l’œil éteint, le visage défait ; ne marchant pas, se traînant… Une forte indemnité est seule capable de le guérir ; aussi ne le mène-t-on pas chez le médecin, mais chez l’agent d’affaires.
Il y a beaucoup d’agents d’affaires en Algérie, presque autant que de sauterelles. Le métier est bon, paraît-il. Dans tous les cas, il a cet avantage qu’on y peut entrer de plain-pied, sans examens, ni cautionnement, ni stage. Comme à Paris nous nous faisons hommes de lettres, on se fait agent d’affaires en Algérie. Il suffit pour cela de savoir un peu de français, d’espagnol, d’arabe, d’avoir toujours un code dans ses fontes, et sur toute chose le tempérament du métier.
Les fonctions de l’agent sont très variées : tour à tour avocat, avoué, courtier, expert, interprète, teneur de livres, commissionnaire, écrivain public, c’est le maître Jacques de la colonie. Seulement Harpagon n’en avait qu’un, de maître Jacques, et la colonie en a plus qu’il ne lui en faut. Rien qu’à Milianah, on les compte par douzaines. En général, pour éviter les frais de bureau, ces messieurs reçoivent leurs clients au café de la grand’place et donnent leurs consultations — les donnent-ils ? — entre l’absinthe et le champoreau.
C’est vers le café de la grand’place que le digne Iscariote s’achemine, flanqué de ses deux témoins. Ne les suivons pas.
En sortant du quartier juif, je passe devant la maison du bureau arabe. Du dehors, avec son chapeau d’ardoises et le drapeau français qui flotte dessus, on la prendrait pour une mairie de village. Je connais l’interprète, entrons fumer une cigarette avec lui. De cigarette en cigarette, je finirai bien par le tuer, ce dimanche sans soleil !
La cour qui précède le bureau est encombrée d’Arabes en guenilles. Ils sont là une cinquantaine à faire antichambre, accroupis, le long du mur, dans leurs beurnouss. Cette antichambre bédouine exhale — quoique en plein air — une forte odeur de cuir humain. Passons vite… Dans le bureau, je trouve l’interprète aux prises avec deux grands braillards entièrement nus sous de longues couvertures crasseuses, et racontant d’une mimique enragée je ne sais quelle histoire de chapelet volé. Je m’assieds sur une natte dans un coin, et je regarde… Un joli costume, ce costume d’interprète ; et comme l’interprète de Milianah le porte bien ! Ils ont l’air taillés l’un pour l’autre. Le costume est bleu de ciel avec des brandebourgs noirs et des boutons d’or qui reluisent. L’interprète est blond, rose, tout frisé ; un joli hussard bleu plein d’humour et de fantaisie ; un peu bavard, — il parle tant de langues ! un peu sceptique, il a connu Renan à l’école orientaliste ! — grand amateur de sport, à l’aise au bivouac arabe comme aux soirées de la sous-préfète, mazurkant mieux que personne, et faisant le cousscouss comme pas un. Parisien, pour tout dire ; voilà mon homme, et ne vous étonnez pas que les dames en raffolent… Comme dandysme, il n’a qu’un rival : le sergent du bureau arabe. Celui-ci — avec sa tunique de drap fin et ses guêtres à boutons de nacre — fait le désespoir et l’envie de toute la garnison. Détaché au bureau arabe, il est dispensé des corvées, et toujours se montre par les rues, ganté de blanc, frisé de frais, avec de grands registres sous le bras. On l’admire et on le redoute. C’est une autorité.
Décidément, cette histoire de chapelet volé menace d’être fort longue. Bonsoir ! je n’attends pas la fin.
En m’en allant je trouve l’antichambre en émoi. La foule se presse autour d’un indigène de haute taille, pâle, fier, drapé dans un beurnouss noir. Cet homme, il y a huit jours, s’est battu dans le Zaccar avec une panthère. La panthère est morte ; mais l’homme a eu la moitié du bras mangée. Soir et matin il vient se faire panser au bureau arabe, et chaque fois on l’arrête dans la cour pour lui entendre raconter son histoire. Il parle lentement, d’une belle voix gutturale. De temps en temps, il écarte son beurnouss et montre, attaché contre sa poitrine, son bras gauche entouré de linges sanglants.
A peine suis-je dans la rue, voilà un violent orage qui éclate. Pluie, tonnerre, éclairs, siroco… Vite, abritons-nous. J’enfile une porte au hasard, et je tombe au milieu d’une nichée de bohémiens, empilés sous les arceaux d’une cour moresque. Cette cour tient à la mosquée de Milianah ; c’est le refuge habituel de la pouillerie musulmane, on l’appelle la cour des pauvres.
De grands lévriers maigres, tout couverts de vermine, viennent rôder autour de moi d’un air méchant. Adossé contre un des piliers de la galerie, je tâche de faire bonne contenance, et, sans parler à personne, je regarde la pluie qui ricoche sur les dalles coloriées de la cour. Les bohémiens sont à terre, couchés par tas. Près de moi, une jeune femme, presque belle, la gorge et les jambes découvertes, de gros bracelets de fer aux poignets et aux chevilles, chante un air bizarre à trois notes mélancoliques et nasillardes. En chantant, elle allaite un petit enfant tout nu en bronze rouge, et, du bras resté libre, elle pile de l’orge dans un mortier de pierre. La pluie, chassée par un vent cruel, inonde parfois les jambes de la nourrice et le corps de son nourrisson. La bohémienne n’y prend point garde et continue à chanter, sous la rafale, en pilant l’orge et donnant le sein.
L’orage diminue. Profitant d’une embellie, je me hâte de quitter cette cour des Miracles et je me dirige vers le dîner de Sid’Omar ; il est temps… En traversant la grand’place, j’ai encore rencontré mon vieux juif de tantôt. Il s’appuie sur son agent d’affaires ; ses témoins marchent joyeusement derrière lui ; une bande de vilains petits juifs gambade à l’entour… Tous les visages rayonnent. L’agent se charge de l’affaire : Il demandera au tribunal deux mille francs d’indemnité.
Chez Sid’Omar, dîner somptueux. — La salle à manger ouvre sur une élégante cour moresque, où chantent deux ou trois fontaines… Excellent repas turc, recommandé au baron Brisse. Entre autres plats, je remarque un poulet aux amandes, un cousscouss à la vanille, une tortue à la viande, — un peu lourde mais du plus haut goût, — et des biscuits au miel qu’on appelle bouchées du kadi… Comme vin, rien que du champagne. Malgré la loi musulmane Sid’Omar en boit un peu, — quand les serviteurs ont le dos tourné… Après dîner, nous passons dans la chambre de notre hôte, où l’on nous apporte des confitures, des pipes et du café… L’ameublement de cette chambre est des plus simples : un divan, quelques nattes ; dans le fond, un grand lit très haut sur lequel flânent de petits coussins rouges brodés d’or… À la muraille est accrochée une vieille peinture turque représentant les exploits d’un certain amiral Hamadi. Il paraît qu’en Turquie les peintres n’emploient qu’une couleur par tableau : ce tableau-ci est voué au vert. La mer, le ciel, les navires, l’amiral Hamadi lui-même, tout est vert, et de quel vert !…
L’usage arabe veut qu’on se retire de bonne heure. Le café pris, les pipes fumées, je souhaite la bonne nuit à mon hôte et je le laisse avec ses femmes.
Où finirai-je ma soirée ? Il est trop tôt pour me coucher, les clairons des spahis n’ont pas encore sonné la retraite. D’ailleurs, les coussinets d’or de Sid’Omar dansent autour de moi des farandoles fantastiques qui m’empêcheraient de dormir… Me voici devant le théâtre, entrons un moment.
Le théâtre de Milianah est un ancien magasin de fourrages, tant bien que mal déguisé en salle de spectacle. De gros quinquets, qu’on remplit d’huile pendant l’entr’acte font l’office de lustres. Le parterre est debout, l’orchestre sur des bancs. Les galeries sont très fières parce qu’elles ont des chaises de paille… Tout autour de la salle, un long couloir, obscur, sans parquet… On se croirait dans la rue, rien n’y manque… La pièce est déjà commencée quand j’arrive. A ma grande surprise, les acteurs ne sont pas mauvais, je parle des hommes ; ils ont de l’entrain, de la vie… Ce sont presque tous des amateurs, des soldats du 3e ; le régiment en est fier et vient les applaudir tous les soirs.
Quant aux femmes, hélas !… c’est encore et toujours cet éternel féminin des petits théâtres de province, prétentieux, exagéré et faux… Il y en a deux pourtant qui m’intéressent parmi ces dames, deux juives de Milianah, toutes jeunes, qui débutent au théâtre… Les parents sont dans la salle et paraissent enchantés. Ils ont la conviction que leurs filles vont gagner des milliers de douros à ce commerce-là. La légende de Rachel, israélite, millionnaire et comédienne, est déjà répandue chez les juifs d’Orient.
Rien de comique et d’attendrissant comme ces deux petites juives sur les planches… Elles se tiennent timidement dans un coin de la scène, poudrées, fardées, décolletées et toutes raides. Elles ont froid, elles ont honte. De temps en temps elles baragouinent une phrase sans la comprendre, et, pendant qu’elles parlent, leurs grands yeux hébraïques regardent dans la salle avec stupeur.
Je sors du théâtre… Au milieu de l’ombre qui m’environne, j’entends des cris dans un coin de la place… Quelques Maltais sans doute en train de s’expliquer à coups de couteau…
Je reviens à l’hôtel, lentement, le long des remparts. D’adorables senteurs d’orangers et de thuyas montent de la plaine. L’air est doux, le ciel presque pur… Là-bas, au bout du chemin, se dresse un vieux fantôme de muraille, débris de quelque ancien temple. Ce mur est sacré : tous les jours les femmes arabes viennent y suspendre des ex-voto, fragments de haïcks et de foutas, longues tresses de cheveux roux liés par des fils d’argent, pans de beurnouss… Tout cela va flottant sous un mince rayon de lune, au souffle tiède de la nuit…
Source: http://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_de_mon_moulin