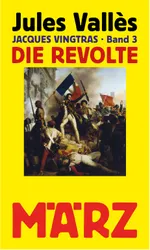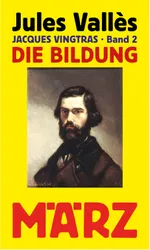Jules Vallès
Journaliste, écrivain, homme politique (1832 – 1885)
LE DIMANCHE D’UN JEUNE HOMME PAUVRE
OU
LE SEPTIÈME JOUR D’UN CONDAMNÉ
8 h. du matin.
Il fait grand jour ; hier, l’on s’est couché tard. Les hommes de lettres font le samedi, comme les cordonniers le lundi.
Dans votre escalier, on court, on se heurte, on crie, on chante. C’est une suite de bonjours, d’embrassades et de gros rires. Dehors, c’est la chanson monotone et lourde qu’entonnent les cloches sur les églises.
Par la fenêtre arrive un jour pâle et mélancolique ; le soleil est froid, son regard est triste, et le cœur se serre sans qu’on sache pourquoi… On découvre une lacune dans son roman, une invraisemblance dans sa pièce, des trous à son pantalon ; on n’a de courage à rien, on se sent pauvre, bête et lâche.
Les heures seront longues et tristes aujourd’hui.
C’est dimanche !
Tenez ! voici son parrain qui monte ; le M. Dimanche de Molière, revu et considérablement corrigé par la société nouvelle. On ne le roule plus aujourd’hui ; il n’est plus votre dupe, vous êtes sa victime ; il vous faut tôt ou tard passer sous les fourches caudines de ce Samnite.
Cependant le créancier du septième jour n’est pas le même que le créancier de semaine. C’est souvent un compatriote qui, parce qu’il est de votre endroit, vous a fait à crédit un habit et un pantalon noir, costume de cérémonie que vous avez traîné dans toutes les brasseries et abreuvé de bière du Nord. Il vient donc, le dimanche, comme un ami après son travail, vous parler de ses petites affaires, de ses petits enfants, et vous montrer la petite note ! Il vous prend par la pitié, pleure dans vos draps, vous offre vos effets, les brosse, et il ne faut pas moins pour le chasser que l’arrivée d’une visiteuse, que vous faites passer pour une marquise, votre maîtresse, en le faisant passer, lui… par une autre porte.
Il part, vous ouvrez ; c’est la blanchisseuse ! Cette femme — du monde qui savonne — vous apporte le linge hebdomadaire avec un papillon blanc taché de noir piqué au ventre d’une chemise. Vous connaissez l’insecte ; il y en a une collection dans votre tiroir marquée en chiffres connus. Celui-ci est gros : trois francs cinquante centimes. Vous avez vingt sous dans la poche de votre gilet : comment éloigner l’ennemi ? En lui donnant à laver d’autre linge ou un ouvrage de vos amis — marqué trois francs, prix fort.
Et vous restez seul avec votre chemise ! trop heureux encore ! tant d’autres n’en ont pas ! tel poète que je connais, par exemple, qui, quand il veut changer de linge, prend du papier et une plume, écrit sur le revers Longueville, et se passe cette guirlande au cou !
N’importe, vous êtes triste ; tout cela n’est pas gai. A ce métier, l’esprit se gâte, le cœur se fane. Et alors qu’il faudrait, pour vous distraire des douloureuses rêveries, une chanson joyeuse à vos oreilles, l’éclat du rire entre des lèvres roses, sous votre fenêtre, dans la cour, une voix de femme pleure sur un ton nasillard quelque romance de Paul Henrion. On ne l’entend que ce jour-là. C’est le crapaud qui vient pousser sa plainte hebdomadaire, lâcher aussi sa petite note. C’est le la du dimanche.
On passe son paletot, on ouvre ses croisées. Aux fenêtres voisines, des hommes velus s’écorchent le poitrail avec des serviettes de toile jaune.
Car voici le grand jour de la lessive humaine.
Ce sont les artisans honnêtes qui essuient la poussière du travail, comme les soldats la poudre après la bataille.
On descend.
La rue a aujourd’hui une nouvelle physionomie. On ne se croirait plus dans son quartier, pas même dans son pays.
Au lieu des jeunes femmes en petit bonnet qui passent tous les matins, leur panier à ouvrage au bras, on n’aperçoit que demoiselles en chapeaux qui vont comme le diable. Tout le monde, du reste, marche vite à cette heure-là : les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes et les Auvergnats. On court chez un ami, chez le coiffeur, chez la modiste, chez grand’papa, chez grand’maman… On dirait des morceaux d’un serpent coupé qui se cherchent.
Les morceaux mâles ont ce jour-là des couvre-chef achetés au : Halte-là ! ne passez pas sans lire ! Au bout de tous les bras s’étendent, comme des taches, des gants de laine ou de chevreau mort-né, au bout des gants des morceaux de bois qu’on appelle des cannes.
Le dimanche est le Mardi-Gras des cannes et des gants.
Des hommes qui paraissent avoir les reins cassés et qui jettent leurs jambes de droite et de gauche, comme s’ils n’en voulaient plus, promènent dans les rues des paquets enveloppés de serge noire, et cognent tous les passants. Ces déhanchés sont des tailleurs qui vont chez la pratique. C’est le dimanche qu’on étrenne les redingotes à ressource et les culottes à fond de bois.
Cependant, chez les charcutiers, des mères de famille en déshabillé et des enfants morveux vont soulever le couvercle en fer-blanc de la boîte aux saucisses, et piquent la fourchette dans les boyaux qu’on vend sous des noms divers à une population abrutie — ou bien on commande une assiette assortie, — de la cochonaille en alinéas. Le petit salé triomphe.
Sous les quais, on voit descendre des hommes à la mine grave, à l’œil rêveur, qui regardent avec mélancolie des vers se tordre dans du son. Ce sont les victimes de la pêche à la ligne, des Français qui, détournés par leurs occupations ordinaires de leur fatale passion, viennent, le jour du repos, s’y livrer avec fureur, et oublier sur le bord de l’eau, sous-chef, femme, enfants et patrie !
Là-haut, au milieu du chemin, deux rosses poitrinaires, traînent un fiacre taché de boue, dans lequel un Pierrot éreinté dort d’un sommeil pénible, sur l’épaule d’une catin levée la nuit au bal.
On se trouve seul au milieu de cette foule armée de cannes, de gants, de paquets et de lignes à ablettes ; et l’on cherche dans son esprit quel camarade l’on pourrait bien aller voir pour égorger l’ennui. Les camarades, les amis, où sont-ils, ce jour-là ? L’employé n’est pas à son bureau, un autre est chez son père, cet autre chez sa maîtresse ; celui-ci déjeune aux Batignolles, celui-là cherche à déjeuner.
On va prendre ses quatre de riz ou ses cinq de chocolat à la crémerie habituelle. Ce ne sont plus les mêmes gens, les mêmes petites ouvrières honnêtes et… autres, qui vous souriaient comme à un camarade de misère ; les voisins de table à qui l’on retenait le Siècle…, la bonne est triste, le lait tourne.
Que faire ? de la fausse monnaie ? Pas d’outils. De l’argent ? Où, chez qui, comment ? Il n’y a pas 7 fr. 50 à emprunter dans Paris maintenant ! Une culotte vous reste, un paletot gris, un gilet vert. Le mont-de-piété est là !
Insensé, ignorant ! Le mont-de-piété est encore ouvert, mais ouvert aux heureux ! On dégage jusqu’à midi : mais
ON N’ENGAGE PAS LE DIMANCHE !
Auriez-vous dans votre gousset une lettre de change sur M. Bapaume ou M. Mirès, vous ne toucherez pas plus l’une que l’autre. Banquiers, correspondants, tous ont fermé la caisse. La poste a changé ses heures, les courriers partent plus tard ; les locomotives font leur dimanche.
Les sangsues même font relâche. Les marchands d’habits borgnes, ceux qui prêtent cinq francs sur le paletot d’hiver, et quarante sous sur la grande, ceux-là aussi ferment leur baraque. A travers le carreau cassé, qui porte un bandeau de papier sur l’œil, on voit bien trembler quelque guenille, on entend bien aussi quelque bruit dans le fond. Mais il est inutile de frapper, le prêteur n’ouvrirait pas ; le vampire digère.
Midi.
Où donc porter ses pas et quels lieux visiter ? (Ponsard.)
LA MORGUE.
Peut-être trouverait-on sur les dalles quelqu’un de sa connaissance, son bottier, par exemple. Ce spectacle jetterait un peu de gaieté dans l’âme. Mais non : ces gens-là ne meurent que quand on les a payés ! Il a encore longtemps à vivre.
LES CAFÉS.
Dans la semaine, on va faire un tour au café. Si l’on n’a pas d’argent, on a toujours un ami en face duquel on s’assied, comme si l’on avait une confidence solennelle à lui faire. Quand le garçon demande : Que faut-il servir à monsieur ? Grog ? demie ? On répond un : Je m’en vais, significatif. Le garçon, qui connaît ce genre de consommation, s’éloigne, et l’on reste deux heures à la table.
Mais c’est aujourd’hui une autre population qui envahit le local, ceux-là même qui ont des figures connues ont une autre tournure et d’autres airs de tête. Les consommateurs sont agités, bruyants. Ils jouent des parties de cartes interminables, ou remuent, comme un chapelet de vieilles dents, un jeu de dominos crasseux qu’ils font tourner avec frénésie en attendant le moment favorable pour passer leur double.
On se résigne donc. On pèse dans sa poche ce qui reste après déjeuner sur la pauvre pièce de vingt sous ; on compte, on se décide, et l’on demande sa demi-tasse sans petit verre. On contemple avec tristesse le ventre jaune des carafons, qui ne se déboutonnent, hélas ! que pour la somme de 20 centimes…
Cependant, autour de vous, des gaillards à la mine rose, en gilet long, en culottes courtes et en guêtres jaunes, s’arrosent le gosier avec une insolente générosité, et prodiguent les consolations à leurs glorias. Ce sont des laquais de bonne maison. Ils campent fièrement sur l’oreille leur melon de velours ou leur casquette aux tons luisants — le casque en cuir bouilli de la domesticité.
Vous cherchez les journaux. Tous sont en main. Un monsieur à lunettes jette le Figaro avec un air de dédain. Vous l’empoignez. Malheureux ! tu l’as lu, relu, avec l’Illustration, le Monde Illustré, le Journal amusant et tous les petits journaux ennuyeux, datés d’aujourd’hui, nés d’hier.
On se tourne alors mélancoliquement vers le billard. C’est bien autre chose ! on y joue des parties à quatre ; c’est une forêt de queues en délire. On regarde la règle, on fait rouler de petites boules en bois peint sur des tringles sales.
« Guâtre aux chaûnes, » dit un Alsacien.
« Chè moa qui a les noerrs, » mâche l’Auvergnat.
« Et moi, les rouzes, » dit le Marseillais.
Et tout ce monde-là vous flanque des coups de queue dans la tête, puis vous demande pardon en vous grattant vos bosses. — Et les cous de se tendre, les jambes dé se lever ; ils suivent la bille des yeux, des reins, du derrière !
« Forcez, la blanche ! — Assez, la rouge ! — Collez-vous ! — Passe derrière. — Va toujours ! — Là !… très bien !… — Elle est masquée. — La grosse queue ! »
Pendant que les hommes jouent, les femmes font des canards et cherchent les images.
On se lève. Pour atteindre à son chapeau, il faut marcher sur des queues de chien, des têtes d’enfant, froisser les jupes, renverser les verres, et, par-dessus le marché, s’entendre appeler, à mi-voix : « Maladroit ! butor ! grand râpé ! » Vous mettez la main au bouton de la porte, une voix sinistre prononce votre nom. Vous vous retournez. C’est un créancier à vous qui prend une cruche avec un confrère. Il vous parle par-dessus la table : « Pensez-vous à moi ? Il y a bien longtemps que ça dure… On ne me donne pas le cuir… » Tout cela dit avec une discrétion hypocrite, de façon à ce que les voisins entendent et écartent leurs chaises en se signant. N’allez pas au café ce jour-là ; on n’y trouve que des domestiques, des esclaves et des créanciers.
Le dimanche, si triste pour l’homme libre, est le jour de fête des vaincus. C’est ce jour-là que les règlements ouvrent aux visiteurs les portes des hôpitaux et des prisons.
Ceux qu’ont jetés à Sainte-Pélagie les hasards de la politique, ceux qui expient dans le grand jardin triste de Clichy leurs folies de jeunesse, tous ces exilés de la vie militante attendent en frémissant les visites amies. Les cœurs battent dans la prison quand le pas du gardien préposé au parloir retentit dans la galerie. « Est-ce pour moi que l’on vient ? » se dit chacun en prêtant l’oreille. Et l’on reprend triste et découragé sa promenade solitaire, si c’est un autre nom qu’a prononcé la voix indifférente de l’homme à casquette étoilée d’argent.
Dans les hôpitaux, de pauvres garçons aux joues creuses, aux yeux éteints, viennent tendre à travers le guichet leurs mains que fait trembler la fièvre. Triste spectacle !
De ce côté la santé et la vie, mais l’inquiétude et la douleur.
De l’autre côté de la grille, dans l’antichambre de la mort, des casaques grises, et des bonnets de coton blanc qui ne font plus rire, je vous jure, et qui retombent en plis tristes sur des têtes pâlies.
Mais dans le monde où nous vivons, on ne va guère à l’hôpital que pour boire du vin ou pour mourir. Les vieux de la vieille et les vieux de la jeune le savent bien. L’amitié d’un interne vous ouvre pour quinze jours un réfectoire. Ce sont des relais de santé, où s’arrêtent chacun à leur tour les ambitieux qui courent la poste sur le chemin de la gloire. Pendant quinze jours, on déjeune et l’on dîne, on boit du sang de rosbif et de raisin, et l’on quitte le râtelier un peu plus gras, un peu plus fou, pour enfourcher de nouveau son dada et dévorer la route.
Pourquoi aller voir ceux-là ? pourquoi aller voir les autres, ceux qui ne sont venus que pour mourir ? Pendant dix ans, ils ont gardé suspendu un point d’interrogation dans leur estomac creux. Mangerai-je aujourd’hui ? mangerai-je demain ? Ils ont cru que la faim ne mordrait pas sur leur santé parce que la fièvre les soutenait, colorait leurs joues pâles, allumait leurs yeux noirs ; ils ont ri au nez de la misère, et elle s’est vengée. Ils ne pourraient même plus se traîner jusqu’au parloir, et pour causer avec eux du temps passé, pour écouter leurs suprêmes paroles, le jour est mal choisi. Il faut au mourant qui murmure la sainte majesté du silence. Et dans ces salles si tranquilles va tout à l’heure entrer avec fracas une foule banale. Sur le parquet jaune vont se traîner, en le rayant, les souliers ferrés de l’ouvrier et les sabots du paysan ; triste refrain pour un De Profundis.
Il ne fait pas bon mourir le dimanche.
Les églises elles-mêmes n’ont plus l’aspect solennel du temple, où venaient s’agenouiller dans l’ombre les Madeleines. Il y a bien des coquettes et bien des indifférentes ; seule la Charité veille aux portes. Les dames quêteuses tendent de leur main blanche la bourse à glands d’acier ; je laisse tomber un sou dans l’aumônière. Le suisse, qui joue avec le fer de sa lance, me jette un regard de mépris.
En sortant de la messe, quelques femmes vêtues de noir se réunissent et prennent le chemin du cimetière ; elles vont pleurer sur des tombes, attacher à la grille du caveau ou à un bras de la croix noire une couronne d’immortelles. Seuls les morts dans la fosse commune dorment sans fleurs et sans prières.
2 heures.
Les maisons sont abandonnées, les magasins fermés, les portes closes. Tout Paris est dehors, et pourtant la plupart des rues sont vides. Ceux qui passent vont lentement et sans bruit, comme des gens qui suivent un enterrement. On dirait qu’un fléau a passé par là : la guerre ou le choléra.
Plus de camions roulant avec fracas sur le pavé, plus de charrettes se heurtant au coin des rues ! Elles dorment dans les chantiers, sous les hangars et dans les cours, les reins à terre, les bras en l’air, et, habitué que l’on est au gémissement des essieux, aux hennissements des chevaux, aux jurons des charretiers, on regarde avec tristesse rouler les petites voitures de place et les longs omnibus conduits par des cochers muets.
Le gamin de Paris, cette sauterelle de la rue, n’est pas là qui gambade entre les pieds des bêtes et les jambes des hommes, jetant au vent son coup de sifflet ou sa chanson. Le cri nasillard du marchand d’habits, la fanfare du fontainier, l’appel plaintif du Savoyard : morts, tous ces bruits, tous ces refrains ! La vie a disparu ; les vivants même ont l’air de n’avoir point d’âme.
Dans la semaine, on va, on vient, on se rencontre, on se bouscule, flâneur ou employé, riche ou pauvre, député, artiste, ouvrier, les paresseux et les vaillants, tous s’agitent, sortent d’ici, courent là-bas, cherchent ceci, cela, du pain, de la gloire, une femme, une rime, un million. Ils vont au bureau, au cours, au journal ou à l’atelier, chez le notaire, chez l’usurier.
Aujourd’hui, ils se promènent ! mot bête ! Tout Paris est sur les boulevards, rue de Rivoli, dans les jardins publics, aux Tuileries, aux Champs-Élysées. Le long des trottoirs et des allées, on voit descendre à petits pas une foule tranquille, émaillée de redingotes vertes et d’habits noirs, de bonnets en tulle et de capotes à plume ; de temps en temps, passe un polytechnicien, le manteau sur l’épaule, ou un élève de Saint-Cyr les mains dans son pantalon rouge, et ici, comme au café, comme partout, le môme abonde ; quelques-uns sont habillés en zouaves avec des culottes fendues par derrière.
Combien est triste et banal ce voyage à travers cette foule épaisse, où se pressent, se mêlent et se heurtent les acteurs en vacance de la grande comédie humaine ! Pas une figure ne se détache en traits heureux sur le fond terne du tableau. Hier samedi, avant-hier, tous les autres jours enfin, les visages reflétaient les âmes, la lèvre était plissée, le pas rapide, le geste vif, le front inquiet, l’œil ardent. Aujourd’hui, le masque est tombé ; on ne voit que des têtes banales sur des épaules bien couvertes ; sourires fades, airs béats. A demain, les affaires sérieuses, les physionomies éclairées au feu des passions sottes ou grandes, la cupidité, l’ambition, l’amour…
Dirai-je les fiacres pleins, les omnibus complets, les bureaux de tabac encombrés ? Les chevaux sont sur les dents, les conducteurs n’entendent pas, il pleut des cigares d’un sou !
Sur les places, les saltimbanques tordent les reins à leurs enfants ; devant l’obélisque, des opticiens râpés enseignent des astronomies révolutionnaires et montrent la lune aux passants.
A travers cette foule, tortillent comme des serpents bruns des bandes de collégiens abrutis, conduits par un pion à barbe rouge, et précédés d’un domestique cagneux en habit de préfet à collet groseille. Deux ou trois petits mulâtres font tache dans la bande. Pauvres enfants ! pauvre homme ! plus à plaindre encore que moi !
Ils sont prisonniers, je suis libre !
Libre ?
Non, tu ne l’es pas, rôdeur au paletot chauve, au chapeau rougeâtre ! Tu passes triste, honteux, au milieu de ces promeneurs en toilette neuve ; tu as peur de rencontrer l’ami riche, le protecteur puissant ; tu n’oses regarder en face les belles créatures qui flânent par là, dans leur cuirasse de soie et de velours ! Tout le monde a l’air heureux ici, les braves gens et les filous, les élégants et les grotesques, les artistes et les notaires, les gandins aux fines moustaches et les souteneurs aux gros favoris, les impures célèbres et les ouvrières modestes, les pères de famille et les mères de louage ; dans la poche du plus mince employé, du plus pauvre artisan, on entend tinter les pièces blanches qu’ils feront sauter sous la forme d’un lapin à la barrière ou d’une grisette au Casino ; dans ta poche, à toi, qu’y a-t-il ? Un manuscrit fripé des bords, avec un titre… qu’on n’escompte pas à la Banque…
Tous les plaisirs te sont défendus. Tu n’entreras même pas au café-concert, où des fruits secs du Conservatoire et de la rue Bréda écorchent Auber et Rossini : le patron se charge des consommateurs. Ne t’arrête pas bien longtemps : le gérant viendra te dire que tu presses trop sur la chaîne.
Il te reste Guignol, Polichinelle, les macarons, la balançoire ; tu peux encore, en te ruinant, monter sur l’Arc de Triomphe, entrer dans la colonne Vendôme, te faire peser — pour voir de combien de livres on maigrit chaque année, dans les lettres.
L’AMOUR !
L’amour nous reste !
Mais le jeune homme pauvre a pour maîtresses les maîtresses de tout le monde ou la femme d’un autre.
Celles de tout le monde, elles vont où fleurit la demi-tasse, le dîner à trente-deux sous, le cheval de bois et le quadrille échevelé ; elles vont aux poches enceintes.
La femme d’un autre, l’épouse adultère, elle est prise aujourd’hui : il est là. A Roger la semaine, au mari le dimanche… C’est lui qui délace le corset de Fanny, ou bien, ce sont les enfants qu’on a amenés de l’école, pauvres petits êtres dont on est jaloux, et qui font à leur mère un rempart de leur innocence… C’est encore la famille des grands parents, qui vous regarde comme un ennemi ; il vous vient presque des remords.
5 h. 40 m.
La foule remonte, les jardins publics se vident, les rues se repeuplent, les restaurants commencent à se remplir. Le patron étire les serviettes, essuie les carafes, presse le chef, gourmande l’officier — cet enfant de troupe de la cuisine.
Cependant, trois familles sont déjà installées. Une julienne ouvre la marche de Balthazar, deux purées croûtons lui succèdent, le rognon saute, le bourgeois frémit, l’orgie commence.
On voit à travers les carreaux l’homme et la femme qui feuillettent la carte, en s’interrogeant d’un air tragique. « A quoi avons-nous droit ? » Tel est le premier cri qui s’échappe des deux bouches (1 potage, 3 plats au choix, un dessert pouvant se remplacer par un petit verre de vespétro (quel nom !), une demi-bouteille de Mâcon (!!) pouvant se remplacer par une bouteille et même deux, si l’on veut y mettre l’argent. Ils se consultent… On les entend demander du faisan ! Il y a donc des gens, au dix-neuvième siècle, après soixante ans de révolution, après les cas d’asphyxie signalés de toutes parts, qui viennent demander du faisan dans les restaurants à 32 sous ?
LE VER SOLITAIRE.
Si aveugles que soient les potages, si faisandé que paraisse le faisan, la vue des plats qui passent met le ventre de belle humeur, les grosses dents se rejoignent, l’estomac tressaille. Le ver solitaire se démène. Tout homme de lettres porte en lui de douze à quinze mètres de ver solitaire. Il ne rend le dernier centimètre que le jour où il est arrivé. Les bonnes femmes nourrissent le leur avec du lait, nous tuons le nôtre avec de l’encre.
On songe donc à faire comme tout le monde, à dîner ! On se dirige machinalement du côté de l’hôtel, vers la pension.
Point de lumière ; le silence ! Un frisson vous court dans le ventre… C’est le lasciate ogni speranza du Dante… c’est le règlement de la table d’hôte.
On ne dîne pas le dimanche !
Reste l’ami calicot ou pion qui vous a donné rendez-vous sous l’Odéon à sept heures pour passer la soirée ensemble en prenant quelque chose. — Les esclaves ont toujours de l’argent dans leurs bottes. — Il vous offrira, au lieu de gloria, le petit pain et la saucisse, l’implacable saucisse ! On ne connaît pas assez à notre époque, l’influence du cochon en littérature. Je connais des hommes de lettres maintenant en route pour l’Académie, qui ont mangé un kilomètre de boudins pendant les années difficiles du noviciat.
Quelques-uns qui, ne pouvant tenir à la peine, sont descendus des hauteurs du Parnasse et du quartier Latin pour entrer comme employés dans un bureau, une étude ou un magasin, se prennent parfois à regretter ce temps d’émotions salées. Ils ont la nostalgie de la saucisse.
Il en est d’autres, au contraire, dont ce régime a perverti les idées, les sentiments, l’estomac. La charcuterie me fait peur, me disait une ancienne victime du boudin littéraire, j’aimerais mieux les garder qu’en manger encore !
On se promène donc de long en long. Les trois boutiques de libraires sont fermées. Seuls, deux élèves de l’École normale et un homme en chapeau pointu lisent les feuilles du soir chez le père Brasseur, le marchand de journaux. Les pas résonnent sur les dalles comme dans les corridors d’un château où il y a encore des revenants. Ici, les revenants se tiennent au bout des galeries, entre des barrières. Des sergents de ville sont là qui les empêchent d’agiter leurs chaînes. Ces ombres attendent que sept heures et demie sonnent à l’horloge du monastère pour aller se perdre dans les Catacombes. Il y aura ce soir tragédie : on donne Britannicus.
Vous, pourtant, vous attendez, l’estomac dans les jambes, la tête en feu ! Mais la saucisse ne vient pas : les boyaux grognent, le cœur se serre ! le cœur, le vrai malade. Dans ce duel avec la faim, ce n’est pas l’estomac qui souffre, c’est l’âme. Mille maux pour un sont plus douloureux ; une migraine, un lombago, une coupure au doigt. Mais il y a dans le spectacle de son impuissance je ne sais quoi de cruel et de sombre qui pousse à la révolte, le pouls bat moins fort que le cœur.
Voilà ce que c’est qu’avoir faim dans le pays des orgueilleux !
Alors on s’en va rôdant à travers les rues, et, par une ironie féroce du hasard, on passe devant les cuisines sérieuses des Foyots, des Janodets… On est pris à la gorge par le parfum des sauces, on s’arrête, l’œil hagard, devant les bassins factices où se crispe dans le jet d’eau l’écrevisse, ce cardinal du ruisseau.
Dans l’intérieur, les cuisiniers vêtus de blanc, comme les sacrificateurs des temps antiques, taquinent le brasier, font voler les couvercles, passent au fil de la broche les perdrix rondelettes, au ventre azuré par les truffes, et les gigots à la Rubens qui pleurent à chaudes larmes dans la lèchefrite… l’oignon siffle, le beurre chante…
Dehors, il fait froid, il fait faim.
Et ces canailles de marmitons qui trempent leur doigt dans la sauce, et se le sucent jusqu’à l’épaule !
LE REPAS DU PHILISTIN.
Il y a bien par là-bas, bien loin, dans la rue des Jeûneurs, une famille du pays qui soupe à huit heures, chez laquelle votre couvert est mis les dimanches et jours fériés, mais la mère est hydropique, la fille à peu près hydrocéphale, le père presque hydrophobe. Il mordrait volontiers aux jambes quiconque parle peinture, théâtre ou roman. On n’y va pas sans muselière.
9 heures.
Où tuer le temps ? quels refuges nous restent ?
LA BRASSERIE.
Elle est pleine de monde et elle est vide, on y trouve deux cents consommateurs, et l’on n’y rencontre personne. Les uns courent le guilledou, d’autres mangent le gigot à l’ail au sein de la famille, quelques-uns dînent chez un camarade frais marié, qui a dit adieu à la vie d’aventures, et met le pot au feu tous les dimanches. Que Dieu fasse bouillir la marmite !
LE RETOUR.
On revient machinalement vers son quartier. Les rues paraissaient tristes à midi. Qu’est-ce donc à cette heure ?
Tout est clos : c’est la nuit, c’est la mort.
Ces magasins, où hier se heurtaient des légions d’employés, où le luxe étalait ses merveilles dans des flots de lumière, ils sont vides, rangés comme des cercueils le long de la voie Appienne. On a éteint le gaz, fermé la porte, soufflé la chandelle. Et les passants vont tâtant les murailles, dérangeant les ivrognes, effarouchant les couples qui s’embrassent sous les portes cochères…
Quelques maisons sont encore ouvertes.
LES ÉPICERIES.
Mais l’épicier n’est plus l’être béat et vil que vous connaissez. C’est la fête dans la salle du fond. On dîne avec le frère et le beau-frère ; le patron, la patronne, et jusqu’à M. Théodore, le garçon au nez violet, tout le monde joue aux cartes autour de la table ronde. Ils ne viennent que quand on connaît l’atout, vous servent en grognant, encaissent sans remercier, et replongent dans l’arrière-boutique.
LES CHANGEURS.
Mais les pièces de cent sous ne dansent pas dans la balance, les billets de banque ne crient pas sous l’ongle ; à peine de temps en temps un Anglais funèbre tourne le bouton de la porte et réveille les louis endormis dans l’écuelle.
Sont encore ouverts les pharmaciens, les herboristes, les marchands de fromage et les charbonniers !
LES CHARBONNIERS.
Existence étrange que celle-là ! on a fait comme un trou au bas d’une maison. Le charbonnier est venu qui a apporté là sa bascule, quatre poids de quarante, quelques cadavres de hêtres coupés en morceaux, sur lesquels il s’acharne, comme un assassin en chambre sur sa victime, à coups de hache, à coups de scie ; il fend le bois, le taille, le rogne, et il le pèse : 13 sous le cotret, 2 fr. 50 c. les 100 livres.
Puis il fait venir le charbon, ce bois de couleur ; il se jette sur lui, le décharge, le met en tas, et à grands coups de pioche il fend le crâne aux pierres noires comme des têtes de nègres déterrés ou d’ours bruns ; la cervelle vole en éclats et inonde de ses débris les mains et le visage du charbonnier. Et ainsi de la charbonnière ! Ainsi des petits carbonari, qui font là-dessus leurs dents, leurs prières et leurs ordures. L’eau est bien là pour laver les flots de poussière ; l’eau, ils la vendent — comme le feu — et ils achètent de la terre. Ils vivent de cette façon dans leur antre, exilés, sous la cuirasse noire, n’ôtant jamais leur masque, pas même le dimanche !
LES MARCHANDS DE FROMAGE.
Passons, passons.
MYSTÈRES !
Derrière des vitres crasseuses, quelques bocaux sales, remplis de poudres blanchâtres ; sur les autres rayons, des pompes foulantes à bec de héron à l’usage du corps humain, des bandages en cuir de gendarme, et des porte-monnaie cousus de fil blanc.
Sur les lettres de renseigne, au-dessus de la porte, pendent comme des cheveux jaunes, des bouquets d’herbe sèche, des bouchons de paille : de chaque côté, en boucles d’oreilles, des chapelets de pavots. Il y a de tout, des éponges qui donnent soif rien qu’à les voir, des pots de pommade, des feuilles de nénuphar, des brosses pour les souliers et pour le ventre, et du chiendent — sous toutes les formes, pour frotter le velours et pour laver les entrailles. Sur le carreau du milieu, une larme verte, et au-dessus cette inscription mystérieuse :
HERBORISTERIE ET SANGSUES.
Ils ne ferment jamais, jamais ! Et pourtant on ne se rappelle pas avoir vu entrer là dedans un être humain. On n’y fait pas de bruit, on y brûle de la chandelle.
Ouvertes encore
LES PHARMACIES.
Ces herboristeries du grand monde, avec leurs bocaux verts, leur odeur fade et rance, leurs serpents dans l’esprit de vin, leurs fœtus confits.
LES PARADIS PROFANES.
Le vice ne fait jamais relâche : les filles perdues traînent leur uniforme dans la boue ; et, au seuil des allées noires, pendent des tabliers blancs sur le ventre des matrones ; c’est le drapeau du régiment.
10 h. du soir, hôtel de l’Étoile, chambre 19.
Il fait sombre, il fait triste !
Hier, on était troublé par le bruit ; on l’est aujourd’hui par le silence. Rien que la voix des horloges qui se répondent d’une tour à l’autre ! Les autres jours on tend l’oreille, on compte les coups ; elles sonnent l’heure du travail ou du plaisir, marquent un accident, rappellent une promesse ou un devoir.
En ce moment, ces heures qui tombent une à une vous disent seulement que vous vieillissez, triste et inconnu, trouvant les journées longues, les années courtes !
On se prend à songer aux dimanches des jeunes années, aux bons dimanches de province qui passaient si vite, ceux-là ! Et dans cette solitude muette, en ce jour de trêve, où la voix du péril n’est point couverte par le bruit du combat, la fièvre tombe, le cœur s’en va…
La mansarde est triste comme la cellule d’un captif ou comme la chambre d’un exilé.
On se couche, et l’on ne dort pas ; on se met à table, et l’on fait de pauvre besogne.
Si cette page vous a paru chagrine et bête, pardonnez-moi.
Je l’ai écrite un dimanche.
Source: wikisource