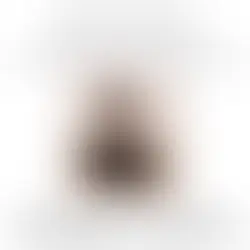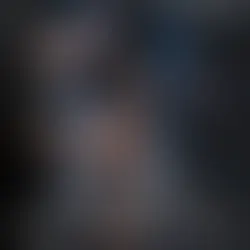Pierre Louis, dit LOUYS, écrivain français né à Gand le 10 décembre 1870 et décédé à Paris le 06 juin 1925.
La Maison sur le Nil ou Les apparences de la vertu
A Claude Debussy
«... C'est fort extraordinaire, dit
Roquentin, et qu'a-t-il fait ?
- Oh! ce qu'il faut faire en pareille
occasion. Il a jeté son pistolet à terre d'un
air de regret. Il l'a jeté si fort qu'il en a
cassé le chien. C'est un pistolet anglais
de Manton. Je ne sais s'il pourra trouver
à Paris un arquebusier qui soit capable de
lui en refaire un»
P. MERIMEE
AMARYLLIS s'étendit toute languissante sur la mousse, et du bout de sa branche de saule toucha la main du plus jeune homme.
«A toi, dit-elle ; parle à ton tour, Clinias. je veux un conte de toi».
Clinias hésita quelque temps.
«J'ai retenu les légendes que tout le monde connaît ; mais je ne sais pas, comme Thrasès, les façonner selon mon esprit, ni comme toi les renouveler par la grâce des mots, Amaryllis. Je dirai ce que m'a raconté mon ami Biôn de Clazomène, à son retour d'Aethiopie.
- C'est une histoire vraie ? demanda Rhéa.
- Oui. Mais j'aime que vous la teniez pour une fable et que les personnages vous semblent suivis de l'ombre de leur symbole. Si j'avais quelque talent, il me faudrait peu de soins pour faire de cette courte histoire un poème en hexamètres. Peut-être seulement la généraliser».
Le soleil brillait très ardent au-dessus de la haute forêt, et la fraîcheur sous les feuilles en était plus délicieuse. Des taches de lumière caressaient Lampito, qui avait ramené sa chevelure sur son visage pour protéger ses yeux fermés. Amaryllis était près de Rhéa. Philinna jouait avec ses mains. Mélandryon regardait la terre.
Alors Clinias commença ainsi :
I
AU delà de Thèbes et de Hermontis, au delà de Silsilis et d'Ombos, Biôn avait remonté le Nil. Même il avait passé l'île Eléphantine, où finit la terre d'Aegypte, et il s'avançait vers la noire Aethiopie, qui est proche des bornes du monde.
Il n'avait pas de barque pour vaincre le cours lent du fleuve, car il eût fallu des esclaves pour manoeuvrer les avirons, et il avait craint de s'imposer des compagnons sans intérêt. Aussi voyageait-il à pied, le long des rives molles et herbues, si étroites, que la route longeait parfois le pied des falaises multicolores, où commençait exactement l'infini montueux du Désert.
Cette mince bande de terre vivante entre deux mornes solitudes, cette voie de champs d'or et d'herbes splendides, fendue jusqu'aux deux horizons par la lumière verte du Nil, retentissait de cris d'oiseaux, stridents et pressés, dans l'air, sur le fleuve, sous les herbes hautes, fourmillant aux branches nues des baobabs obèses, comme d'étourdissantes cigales, perpétuellement.
Des autruches et des girafes arpègeaient au loin les prairies ; des troupeaux d'antilopes fuyaient comme des nuages blonds ; les singes se suspendaient en grappes fantastiques aux souples branches des sycomores, et parfois dans la vase du Nil, où se suivaient comme de longues fleurs les pas effilés des ibis, Biôn contemplait avec étonnement la formidable empreinte humaine laissée par ce mystérieux Amanit, bête que les hommes n'ont jamais pu voir, mais dont les Aethiopiens font d'étranges récits. Et Biôn, inquiet, se persuadait que les Colosses de granit rose, scculptés dans l'épaisseur des montagnes, allaient pendant les solitaires nuits se baigner jusqu'aux genoux dans le fleuve saint qui est père de tout.
Car, si loin de Thèbes et de Memphis, les restes de la splendeur aegyptienne duraient encore en pays impie. Depuis longtemps les autochthones avaient repris la terre sur les conquérants, et pourtant la face de Rhamsès était pour jamais gravée aux falaises, car les souverains du Nord avaient donné leur forme aux roches que le ciseau des esclaves a pu entamer mais que le temps ni Dzeus ne détruiront plus.
C'était l'hiver. Les nuits s'enveloppaient de fraîcheur brumeuse. Les jours éthérés persistaient dans l'accablement. Biôn cherchait l'ombre et les sources dans les forêts de mimosas où les lions se retiraient du soleil et dormaient jusqu'au lever du soir. C'était là aussi que vivaient les hommes, barricadés dans leurs cabanes par des palissades de dattiers. Biôn était leur hôte, de nuit en nuit, et les quittait au premier matin.
II
OR, un soir...
- Enfin ! s'écria Lampito.
- Tu parles bien, dit poliment Philinna ; mais tu es trop pompeux. Et puis, pourquoi nous as-tu donné une petite description de l'Aegypte avant de commencer ton récit ? Je suppose que cela n'a rien à voir avec la suite de l'aventure ?
- Soyez indulgentes, répondit Clinias. L'histoire de Biôn est très simple, je pourrais vous la dire en deux mots, mais ensuite il faudrait en trouver une autre et la chaleur ne me permet pas cet effort d'imagination. D'autre part, c'est une courte scène qui ne saurait être développée. Il faut bien que je la prépare avec quelques phrases inutiles, si je veux avoir fait un conte de la même longueur que les autres. Tout cela est sans réplique. Ne m'interrompez plus.
... Un soir, comme il avait marché longtemps sous un rayonnement douloureux, et que déjà ses pieds fatigués portaient la marque étrécie des courroies, il approcha d'une maison brune et verte, élevée seule au bord du Nil avec de la vase sèche et des stipes entrecroisées. Des palmiers lourdement chevelus croissaient nombreux autour d'elle, et elle était à ce point envahie par les larges herbes du fleuve qu'on l'eût dite flottante sur l'eau même ou en péril dans un marais.
L'épaule reposée contre un arbre, Biôn, immobile, regarda :
Deux jeunes filles, devant l'ouverture de la porte, rieuses par moments, se parlaient.
L'aînée était debout dans une grande étoffe bleue à franges, nouée sous les aisselles, drapée jusqu'aux genoux. Ses innombrables cheveux noirâtres étaient séparés en mille petites tresses minces et dures, qui encadraient de près un visage aux yeux luisants et aux grosses lèvrres, et ne retombaient pas au delà de ses délicates épaules carrées. Elle pliait les reins à une barrière basse. Elle riait un peu et balançait la tête.
La plus jeune n'était pas vêtue, car elle était presque une enfant. Elle se tenait assise sur ses talons, la tête penchée entre les genoux, et piquait de petites fleurs jaunes entre ses orteils écartés.
Il les regardait vivre et ne se montrait pas. Il contemplait la Maison. Ce lieu, mystérieux comme tout ce qui apparaît pour la première fois, lui semblait défendu par ce qu'il avait d'étranger, de solitaire et d'inconnu. Une famille vivait là. Depuis combien de temps ? Quelle quantité de tristesse et de bonheurs furtifs avait fait joyeuse ou morne cette hutte de boue et d'arbres ? Qui l'avait bâtie ? Qui l'avait habitée ? Quelles morts, quelles naissances avait-elle veillées ? Il sentait que tout ce qu'il pourrait apprendre ne lui dirait jamais rien sur elle, et qu'à jamais ce coin perdu lui demeurerait impénétrable.
Le soir s'élevait rapidement. Biôn enfin se montra.
Aussitôt les deux filles, avec de petits cris se retirèrent vers la maison ouverte. Mais il n'approcha pas et dit simplement :
- «Je demande hospitalité.
- Le père est aux champs, répondit l'aînée. Attends qu'il soit venu. Il t'accueillera».
Biôn appuya son bras contre un arbre et tourna ses yeux vers le Nil, importuné par les regards curieux qui se fixaient sur sa personne.
Longtemps après le soleil couché, l'Aethiopien arriva, suivant un boeuf blond aux cornes effilées. Et dès qu'il parut, les deux filles parlèrent à la fois.
«Il y a un étranger. - Il demande hospitalité. - Oui, il est seul. - Là, près de l'arbre. - Nous ne l'avons pas laissé entrer avant ton retour. - Nous avons bien fait, père ?»
Le maître fit trois pas dans l'obscurité, et dit à voix haute :
«Sois le bienvenu. Entre chez moi».
Quand ils furent entrés dans la salle et qu'on eût allumé les lampes de terre cuite :
«Voici l'eau, le pain et les fruits», dit l'Aethiopien.
Ils burent et mangèrent. Et l'hôte ne parlait pas, sachant qu'il est indiscret de poser des questions à qui n'y a pas répondu d'avance.
Celle dont le corps brun était drapé de bleu apportait des mets et versait l'eau des cruches. La cadette s'était reculée jusqu'à la paroi terreuse, et, les mains serrées sur la bouche, considérait l'Etranger.
Quand le repas fut accompli, l'hôte se leva : «Il est temps de gagner ton lit. Je sais les devoirs de l'hospitalité. Voici mes deux filles. La plus jeune n'a pas connu d'homme encore mais elle est d'âge à t'approcher. Va, et prends ton plaisir avec elle».
Biôn n'ignorait pas cet usage, et il le vénérait comme une tradition de vertu singulière. Les dieux visitent souvent la terre, habillés en voyageurs, en soldats ou en bergers, et qui reconnaîtrait un mortel d'un olympien qui ne veut pas se nommer ? Biôn était peut-être Hermès ? Il savait qu'un refus de sa part eût été pris pour un outrage ; aussi n'eut-il ni surprise ni gêne quand l'Aînée se pencha vers lui et découvrit ses jeunes seins pour les lui donner à baiser.
Sans parler, sans bouger, l'enfant regardait leur scandale, et se tenait, la tête en avant, les mains retombées comme en rêve.
Après un instant de pâleur, tremblante, prête à pleurer, elle se précipita dans la porte ouverte. La nuit se referma sur elle.
Le père alors, levant les bras, à son tour marcha jusqu'au seuil, et plongea les yeux dans l'ombre profonde, où sa fille emportait à jamais l'honneur perdu de sa maison.
III
LE soleil était brûlant quand Biôn s'éveilla et prit son sac de peau pour continuer sa route. La maison, déserte.
Il regretta de ne pas rencontrer l'Hôte, mais ne s'étonna point de ne pas revoir la compagne de la nuit. Elle avait trop de sagesse pour se livrer à un adieu.
Il se mit en marche.
Le chemin qu'il suivait le long des roseaux du Nil était si éblouissant qu'il le quitta bientôt pour un petit sentier qui traversait les champs marécageux et se dirigeait vers le bois.
Un hippopotame endormi avait écrasé tout un champ de riz sous sa vaste chair lilas et rose, et la dévastation qui l'entourait était le fait de sa gueule poilue. Biôn l'eut rapidement dépassé. Peu de temps après, il entrait dans l'ombre des mimosas.
Un cri joyeux l'arrêta. Un cri si tendre, si reconnaissant, si gonflé de bonheur parfait, que Biôn se retourna vivement avec un sourire involontaire.
La petite fugitive était devant ses pieds, nue comme la veille, un peu timide, mais rayonnante, et ne demandant qu'un geste de lui, pour se jeter dans ses bras et pleurer de joie.
«Toi, te voilà enfin, dit-elle. Je ne savais pas par où tu passerais. Je ne savais même pas si tu remontais le Nil. Mais j'étais sûre que je te reverrais. Je suis venue ici, j'ai attendu. J'ai bien deviné que tu fuirais le soleil de la route et que tu prendrais par les bois. Oh ! que je suis contente ! Il me semble qu'il y a trois jours que je t'attends... Je ne sais plus... Ce qui m'est arrivé est si extraordinaire...»
Et elle ajouta plus tristement :
«Tu es resté bien longtemps près d'elle».
Biôn se tenait immobile et la regardait avec quelque gêne.
«Mais, ma petite enfant, qu'est-ce que tu viens faire ici ?
- Comment ? s'écria-t-elle. Je viens pour te suivre, pour rester avec toi toujours, toujours...
- Tu viens pour me suivre, et hier quand ton père t'a donnée à moi tu t'es sauvée comme une chèvre folle ? Je ne te plaisais pas hier soir et je te plais ce matin, sans raison ? Tu as des caprices singuliers».
La pauvre fille se tut, puis fondit brusquement en larmes et appuya le long d'un arbre son petit corps nu secoué de sanglots.
Plus que tous les ennuis, Biôn détestait les scènes touchantes. Il frappa du doigt l'épaule de l'enfant, et lui dit :
«Adieu. Retourne chez ton père. Tu lui feras plaisir».
Et il s'en alla tranquillement.
Mais elle courut à lui. Elle le prit par son manteau, par ses bras, par son cou et dit à la hâte :
«J'irai où tu iras, je t'aimais hier comme aujourd'hui, je n'ai jamais aimé personne, je n'aime que toi, je n'aimerai que toi... Je suis partie hier parce que j'étais jalouse de ma soeur, parce que je ne pouvais pas te partager avec ma soeur, ni t'aimer devant elle. Si je ne m'étais pas enfuie, tu m'aurais prise en passant et tu m'aurais déjà quittée. Après toi je me serais prêtée à un autre, et à un autre, et ainsi jusqu'à mon mariage. Sais-tu que ma soeur a déjà connu plus d'étrangers que je ne te dirais en ouvrant sept fois mes deux mains ? Et moi aussi, j'aurais fait cela ? O je sens si bien que toute ma vie j'appartiendrai au même homme, au premier qui m'aura saisie. Et c'est toi celui-là ! Emmène-moi, garde-moi toujours ! Je veux être ta femme et te suivre».
Biôn très ennuyé, répondit :
«Ma chère petite, tu raisonnes comme une enfant. Tu dis toi-même que tu n'as jamais aimé personne et j'en suis bien convaincu, car dans les bras de son premier amant la femme rêve déjà au second, et dans son coeur c'est lui qu'elle aime. Tu verras cela un peu plus tard.
«Il n'y a aucune raison pour aimer toujours le même homme. Te condamnerais-tu à dormir toute la vie sous le même toit ? à porter toujours la même robe ? à manger toujours du même fruit ? L'amour n'est pas un sentiment qui soit très différent des autres, mais de tous c'est le plus abondant : c'est pour cela qu'il faut le partager.
«Les dieux ont semé sur ta bouche un amour assez généreux pour satisfaire toute une armée. Tu n'as pas le droit de priver les autres du plaisir qu'ils espèrent de toi. Quand ta soeur sera mariée, tu resteras seule chez ton père : alors des voyageurs passeront encore, qui depuis longtemps auront quitté leur foyer et le lit sacré de leurs noces. Fatigués du soleil et de la longueur de la route, ils se délasseront par tes soins. Tu peux enchanter leur ennui et laisser dans leur existence le souvenir d'un jour heureux.
«Ainsi, par la suite des jours, la diversité des tendresses, la promptitude des adieux, tu comprendras peu à peu qu'il ne faut pas s'attacher par l'amour, et tu choisiras plus sagement l'homme à qui tu donneras ta vie.
- Pourrai-je jamais mieux choisir ? N'es-tu pas...
- Oh ! je sais. Je suis sans doute le meilleur, le seul, et tu es bien certaine d'avoir trouvé ton rêve. N'est-ce pas ? c'est cela que tu allais dire. Eh bien, vois comme tu t'es trompée. Si je t'aimais ici, dans ce bois, je te laisserais aussitôt après, ainsi que j'ai laissé ta soeur ce matin. Dans l'état où tu es il vaut mieux n'en rien faire et nous quitter simplement. Tu avait fait un choix déplorable. Essaye de l'oublier, et va-t-en tout de suite sans tourner la tête. Dans la Maison sur le Nil, tu retrouveras ton père affligé, le foyer de ta famille et les images des Dieux. Tu reverras ta soeur aînée et elle t'apprendra la Vertu véritable, dont tu ne connais que les apparences».
Il l'embrassa sur la joue et reprit sa route entre les arbres. Mais il n'avait pas encore disparu au delà des grands buissons de fleurs jaunes quand il entendit pour la troisième fois courir et pleurer derrière lui.
Alors il s'emporta tout à fait :
«Je te défends de me suivre !
- Je ne peux pas te quitter. Ne me chasse pas. Je ne demande plus à être femme puisque que tu refuses de m'aimer. Je supplie, pour rester près de toi. Je t'appartiens. Fais de moi quelque chose. Je serai ton esclave si tu veux».
Biôn dénoua froidement sa ceinture, la serra comme un pagne autour des reins de l'enfant, accrocha sur l'épaule nue la courroie du sac gonflé avec la gourde et le pétase et, d'une voix indifférente :
«Va devant», dit-il.
Cette histoire causa quelque scandale, et les femmes ne furent pas éloignées de penser que Biôn était un homme abominable. Ce fut bien pis quand Rhéa, qui voulait toujours connaître la fin dernière des récits et le sort de tous les personnages, eût demandé :
«Qu'arriva-t-il ensuite ?»
Car Clinias termina ainsi :
«Avant le soir du même jour, Biôn la vendit comme esclave à un chef nomade de la plaine, et il ne sait ce qu'elle est devenue».
Les femmes s'indignèrent, mais Thrasès parlait déjà :
«C'était son droit le plus évident. Ne lui avait-elle pas dit : Je t'appartiens ! Le propre des choses qui appartiennent est de pouvoir être vendues. Il n'y a rien à dire là-contre, et d'ailleurs c'était une petite sotte qu'il a bien fait de négliger».
Mélandryon fut plus sévère :
«Ces gens-là, dit-il, sont tous trop vertueux. Il ne faut pas juger les choses sous le rapport du Bien et du Mal. Ce sont des considérations qui varient selon les climats et dont on a beaucoup exagéré l'intérêt. La seule règle de vie qui semble légitime, c'est le souci de la beauté. Si l'enfant était jolie (ce que Clinias a omis de nous dire), Biôn a commis une faute grave en la vendant à un nègre imbécile qui méconnaîtra le charme de ses lignes et la grâce de ses mouvements.
- Elle avait le nez court, répondit Clinias, les lèvres lourdes et la peau brune.
- Dans ce cas, il ne fallait pas s'occuper d'elle», déclara Mélandryon.
Source: http://www.bmlisieux.com/litterature/louys/maison.htm